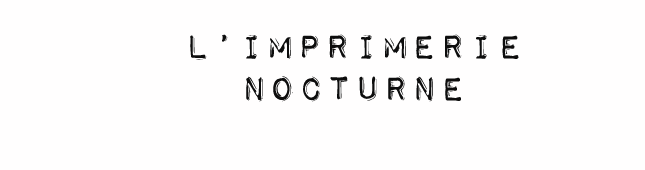Présenté à la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes, le documentaire Nothingwood de Sonia Kronlund arrive sur nos écrans à l’Arvor ce mercredi. Ou comment une réalisatrice brosse un portrait savoureux dans un contexte de guerre de son semblable afghan Salim Shaheem.

« Ici, ce n’est pas Hollywood, ce n’est pas Bollywood, c’est Nothingwood, le cinéma du rien. »
Ainsi l’auteur-réalisateur-producteur Salim Shaheem évoque le septième art au point mort en Afghanistan dont il représente l’exception. Salim Shaheem, 110 films au compteur entre série Z et bluettes musicales indiennes. Une star nationale, un homme à l’égo démesuré et à la truculence joueuse. Personnage massif, mégalo, qui s’invente des mères natives de lieux où il pose sa caméra pour mieux séduire les habitants, qui distribuent des posters à son effigie comme d’autres leurs points au cricket. Mais surtout un amoureux fou du cinématographe. Dans Nothingwood, premier documentaire biographique, la réalisatrice Sonia Kronlund rend hommage avec brio à un artiste qui à la manière du roi du nanard kitch Ed Wood, bricole sa vie en 24 images/seconde depuis trente ans dans des conditions chaotiques. Exercice cathartique entre souvenirs d’enfance et gestes de la vie quotidienne devenus scènes de films. Le cinéma alimente les rêves de Salim Shaheem depuis l’enfance alors que ses frères le frappaient parce qu’il se prenait pour un héros bollywoodien et chantait dans les rues de Kaboul. Des images d’archives historiques et des inserts de scènes de ses propres œuvres jalonnent le récit du réalisateur : tenu pour mort lors d’un guet-apens avec les forces de l’Union Soviétique ou victime d’une explosion de roquettes en plein tournage, l’artiste et son équipe reprennent leur travail advitam, a life bigger than war : l’art nourrit la vie et aide à avancer quel que soit le contexte.

En filigrane, Sonia Kronlund dresse également un état des lieux de l’Afghanistan, pays mal connu en Europe, victime d’occupations belliqueuses successives, qui tente de survivre sous les exactions journalières entre attentats et enlèvements. À Bamiyan, vallée où les Talibans détruisirent trois célèbres statues monumentales de Bouddha en 2001, Salim Shaheem tourne son 111e film. Dans ces paysages montagneux aux crêtes enneigées d’une beauté majestueuse, la caméra de Sonia Kronlund suit la fidèle équipe de comédiens du réalisateur. Une société sans femmes qui restent à la maison, dissimulées derrière des voiles. Le réalisateur refuse d’en parler ou de montrer ses six filles contrairement à ses huit garçons objets d’un dîner familial volubile. Elles habitent le hors-champ à l’exception de brèves apparitions ou d’un témoignage d’une jeune adolescente surveillée par son père. Pourtant, c’est bien une femme qui tient les commandes. Derrière et devant la caméra, Sonia Kronlund oppose, souriante, sa volonté de fer au réalisateur qui s’en amuse et se prête avec gourmandise à l’exercice. In fine, à travers la personnalité iconoclaste de l’acteur fétiche du réalisateur qui aime se travestir en privé pour essayer des burqa comme en public dans une émission télévisée pour dénoncer la difficile condition féminine en Afghanistan, Nothingwood envoie un message vers d’avantage de tolérance. The show must go on !