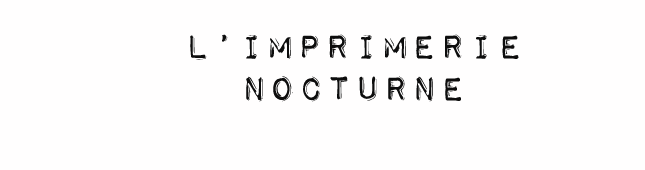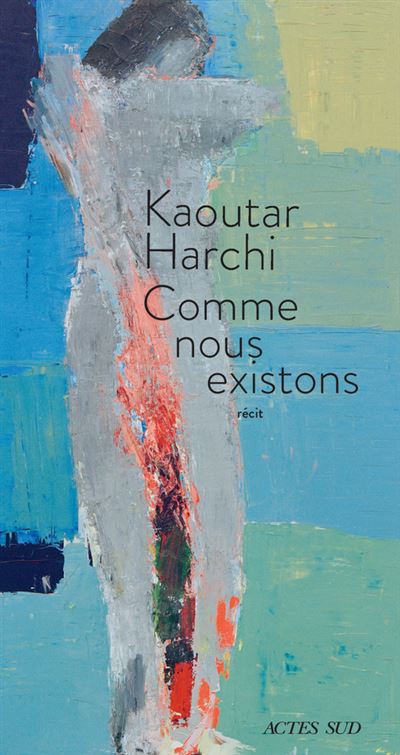Lire Comme nous existons de Kaoutar Harchi, c’est se plonger dans l’autobiographie de l’autrice. C’est aussi gratter le vernis d’une France post-coloniale et ses rapports avec plusieurs générations issues de l’immigration. Un récit aussi douloureux que lumineux par la force de son écriture.
« Hania et Mohamed se souvenaient – et je cherchais à me souvenir avec eux – comme c’était bien, comme c’était simple avant. » (p. 13)
Kaoutar Harchi part d’un fait familial assez simple et imagé : le visionnage de la cassette vidéo du mariage de ses parents, étiquetée « mariage 1984 – Casa ». Un moment heureux, que la petite fille se repasse parfois secrètement. Pour se souvenir de quelque chose qu’elle n’a pas connu ; puis ce sont ses propres souvenirs qui vont occuper le premier plan de son récit. En filigrane pointe déjà la toile de fond d’une existence liée au Maroc et à la France ; et notamment l’arrivée de son grand-père Ba en France dans les années 1960. Puis rapidement l’on suit Kaoutar pour son inscription dans un collège catholique en 1998 : ses parents veulent le meilleur, « d’être une famille à laquelle rien ne devait arriver » (p. 28), elle tâche de ne pas les décevoir. Puis le premier uppercut arrive, dans le bus de l’école ou avec celle qui deviendra sa meilleure amie, Khadija, où elle subit le premier assaut raciste concernant ses cheveux.
« Et cette communauté qu’à nous deux nous avons formée, une communauté de l’expérience, a fini par créer dans l’espace clos de cet autobus, le temps d’un trajet, un lien d’une force terrible ». (p. 35)
L’ensemble du parcours de Kaoutar laisse apparaître au fur et à mesure les différentes fêlures : la difficulté du travail de ses parents, sa classe sociale face aux autres petites élèves qui vivent dans de grandes maisons, la violence dans la rue concernant le voile, et les violences policières ; dont la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré évoquée dans le chapitre « Du fond du grand monde », racontant la tristesse qui se mue en colère. Puis il y a un livre, La Double absence d’Abdelmalek Sayad, qui change la vie de l’autrice : « Ce livre a projeté ses lumières sur mes hantises, mes doutes, mes soupçons. Il fut, entre mes mains, telle une cartographie de notre vie » (p. 91). Car dans son récit autobiographique, Kaoutar cherche une place, sa place, parmi sa famille et les communautés ; une quête de sa propre identité en fin de compte, animée par la conviction que « la justice sous toutes ses formes, pourrait être obtenue par toutes celles et ceux qui la réclament » ; et en cartographiant son existence par le souvenir, l’autrice arrive à rapporter l’intime à la dimension collective. Son chemin, Kaoutar Harchi le mène avec l’envie d’apprendre, puis l’envie d’écrire ; là où l’autrice démarre son récit avec la notion de « voir/aimer », elle le clôt avec celle d’exprimer et de montrer, avec la mémoire et les mots comme matériaux principaux. Comme la photographie qui n’a pu être prise que l’on aimerait tracer avec des phrases, ce besoin de raconter ce qui est ressenti, comme une flèche. Comme nous existons la rendrait presque réelle, cette flèche en plein cœur.