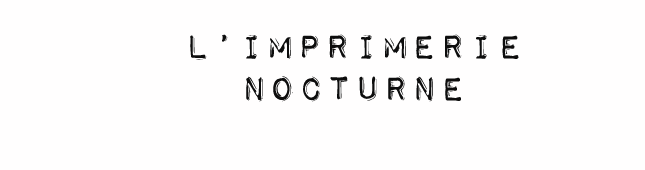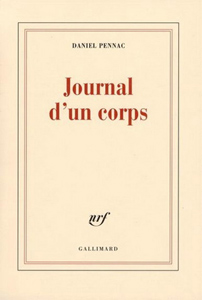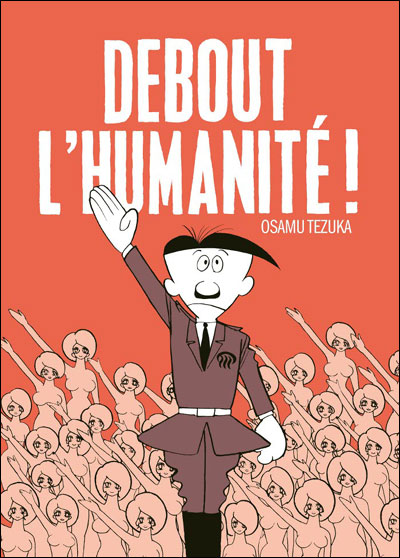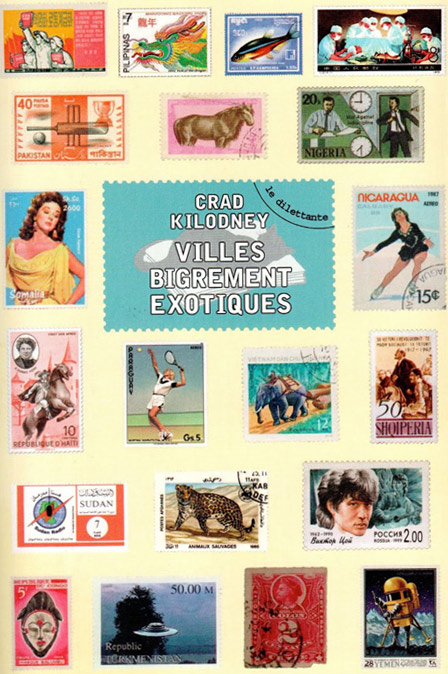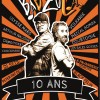Si c’est un homme de Primo Levi : un témoignage à lire, relire et faire lire.
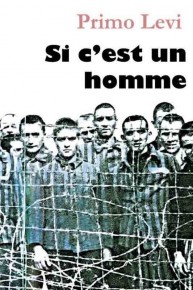 Autant dire que sa description du camp d’Auschwitz-Birkenau est inoubliable, glaciale. Y sont factuellement analysées la vie d’esclave, la déshumanisation des prisonniers soumis à un système de tortures permanentes : séparation des familles dès l’arrivée, froid, faim, humiliations, coups, ordres arbitraires, hygiène lamentable, cauchemars nocturnes, dysenterie, dépersonnalisation via les uniformes rayés mal ajustés, les chaussures dépareillées, les numéros tatoués sur l’avant-bras et cousus sur la poitrine, cheveux rasés, objets personnels proscrits, promiscuité, four crématoire pour les plus faibles, sélections opérées selon une logique incompréhensible (si ce n’est faire de la place pour les arrivants du prochain convoi en provenance de Hongrie ou de tout autre endroit où les rafles sévissent) conduisant les désignés vers les chambres à gaz, deuil de la vie bienheureuse d’avant et la perte des siens, enlaidissement des corps, ballonnements des ventres, plaies aux pieds, eau non potable qui coule des trop rares robinets, grillages électrifiés, brutalité des kapos, fatigue inouïe, appel quotidien qui dure des plombes quelles que soient les intempéries, corvées au milieu de la nuit pour vider le seau collectif : « il nous faut nous traîner jusqu’aux latrines : le seau qui dégage une odeur écœurante, cogne contre nos mollets nus, et comme il a été trop rempli, les secousses le font immanquablement déborder sur nos pieds ; aussi, pour répugnante que soit la besogne, mieux vaut-il encore l’exécuter soi-même que de la voir confier à son voisin de couchette » [car les prisonniers à ce moment-là dans le baraquement de Primo Levi dorment à deux par couchette, tête-bêche] (p. 92-93)…
Autant dire que sa description du camp d’Auschwitz-Birkenau est inoubliable, glaciale. Y sont factuellement analysées la vie d’esclave, la déshumanisation des prisonniers soumis à un système de tortures permanentes : séparation des familles dès l’arrivée, froid, faim, humiliations, coups, ordres arbitraires, hygiène lamentable, cauchemars nocturnes, dysenterie, dépersonnalisation via les uniformes rayés mal ajustés, les chaussures dépareillées, les numéros tatoués sur l’avant-bras et cousus sur la poitrine, cheveux rasés, objets personnels proscrits, promiscuité, four crématoire pour les plus faibles, sélections opérées selon une logique incompréhensible (si ce n’est faire de la place pour les arrivants du prochain convoi en provenance de Hongrie ou de tout autre endroit où les rafles sévissent) conduisant les désignés vers les chambres à gaz, deuil de la vie bienheureuse d’avant et la perte des siens, enlaidissement des corps, ballonnements des ventres, plaies aux pieds, eau non potable qui coule des trop rares robinets, grillages électrifiés, brutalité des kapos, fatigue inouïe, appel quotidien qui dure des plombes quelles que soient les intempéries, corvées au milieu de la nuit pour vider le seau collectif : « il nous faut nous traîner jusqu’aux latrines : le seau qui dégage une odeur écœurante, cogne contre nos mollets nus, et comme il a été trop rempli, les secousses le font immanquablement déborder sur nos pieds ; aussi, pour répugnante que soit la besogne, mieux vaut-il encore l’exécuter soi-même que de la voir confier à son voisin de couchette » [car les prisonniers à ce moment-là dans le baraquement de Primo Levi dorment à deux par couchette, tête-bêche] (p. 92-93)…
Si la sophistication de cette entreprise d’extermination dépasse l’entendement, la narration de cet effroyable quotidien rend cette immense tragédie, la Shoah, tangible. Cette dernière fait naturellement écho avec d’autres incommensurables massacres (la traite négrière, les invasions coloniales accompagnées de leurs lots d’exactions, l’extermination et la déportation des Amérindiens…). Le témoignage de Primo Levi demeure ainsi comme une frêle chandelle. Défiant l’obscurité, l’oubli. À la fois grandiose, miraculeuse et ô combien insuffisante – car, hélas, ce genre de témoignage, pourtant essentiel, fondateur d’une éthique universelle, n’arrive pas aux yeux de toutes et tous, alors même qu’avoir conscience de quels abominables crimes l’Homme est capable et quelles souffrances sont ainsi engendrées est probablement une des façons les plus basiques d’empêcher leur répétition.
« Lorsque, au petit matin, en rang sur la place de l’Appel, nous attendons interminablement l’heure de partir au travail, tandis que chaque souffle de vent pénètre sous nos vêtements et secoue de frissons violents nos corps sans défense, gris dans le gris qui nous entoure ; au petit matin, alors qu’il fait encore nuit, tous les visages scrutent le ciel à l’est, pour guetter les premiers indices de la saison douce, et chaque jour le lever du soleil alimente les commentaires : aujourd’hui un peu plus tôt qu’hier ; aujourd’hui un peu plus chaud qu’hier ; d’ici deux mois, d’ici un mois, le froid nous laissera quelque répit et nous aurons un ennemi de moins. » (p. 107-108)
De l’épreuve ultime à laquelle il a miraculeusement survécu, Primo Levi s’efforce de dégager un enseignement – autant que les souffrances indicibles qu’il a eu à subir servent à quelque chose –, car « le Lager a été, aussi et à bien des égards, une gigantesque expérience biologique et sociale (…) un champ d’expérimentation, pour déterminer ce qu’il y a d’inné et ce qu’il y a d’acquis dans le comportement de l’homme confronté à la lutte pour la vie. » (p. 133-134)
« On a parfois l’impression qu’il émane de de l’histoire et de la vie une loi féroce que l’on pourrait énoncer ainsi : “Il sera donné à celui qui possède, il sera pris à celui qui n’a rien.” Au Lager, où l’homme est seul et où la lutte pour la vie se réduit à son mécanisme primordial, la loi inique est ouvertement en vigueur et unanimement reconnue (…) Mais les “musulmans”*, les hommes en voie de désintégration, ceux-là ne valent même pas la peine qu’on leur adresse la parole (…) on sait qu’ils sont là de passage, et que d’ici quelques semaines, il ne restera d’eux qu’une poignée de cendres dans un des champs voisins, et un numéro matricule coché dans un registre. » (p. 136-137)
Si c’est un homme, au-delà du témoignage « classique » sur les camps de la mort nazis, est aussi une étude de l’âme humaine, d’une finesse et d’une dureté indépassable. Au-delà du bien et du mal. Pourquoi certains sont voués à une mort certaine et pourquoi d’autres, considérés comme des prominents, dans ces conditions épouvantablement dégradées, s’en sortent, au prix de mille astuces, de marchandages illicites, de combines, d’échanges de bons procédés, de larcins, de complicités, de négociations, d’une persévérance sans faille, d’une volonté inexpugnable, abandonnant au besoin toute dignité ou sachant faire preuve de cruauté pour éliminer un rival ? Savoir observer (quand tout autour de soi n’est que nuit et brouillard), s’adapter (même au pire) sont vraisemblablement des facteurs favorisant la chance de s’en sortir vivant. La présence de son père, longtemps à ses côtés, a dans le cas de Primo Levi, sûrement eu aussi un rôle essentiel.
En annexe, des réponses aux questions récurrentes que des élèves lui posent sont apportées par Primo Levi qui explique, inlassablement, l’impossibilité de résister, de se révolter, à laquelle étaient conduits les déportés (par épuisement extrême, par difficulté à se comprendre tant les langues sont diverses au Lager, par ignorance de la région où ils étaient, par manque d’appui à l’extérieur et de stabilité à l’intérieur des Lagers tant le turn-over des prisonniers est élevé et leur espérance de vie archi-limitée) ou bien la différence entre les camps d’extermination nazis (d’où dans 90 à 98 % des cas on ne ressortait pas) et les goulags (d’où, au bout de longues peines arbitraires, les détenus ressortent néanmoins).
S’il était encore de ce monde, Primo Levi (qui s’est donné la mort en 1987) n’aurait peut-être pas attendu le salut nazi d’Elon Musk le jour de l’investiture de Donald Trump pour considérer qu’acheter une Tesla n’était pas le plus éthique des investissements…
* « “Muselmann” [mot yiddish] : c’est ainsi que les anciens du camp surnommaient, j’ignore pourquoi, les faibles, les inadaptés, ceux qui étaient voués à la sélection. » (NdA, Ndbp, p. 135) « Les Muselmänner, les damnés, le nerf du camp ; eux, la masse anonyme, continuellement renouvelé et toujours identique, des non-hommes en qui l’étincelle divine s’est éteinte. » (p. 138)
Post-scriptum : On ne remerciera jamais assez les petites librairies de quartier, comme L’Établi des Mots, qui s’efforcent de mettre en avant des livres importants.
Si c’est un homme, Primo Levi, 1958, Éditions Julliard, 1987, postface de l’auteur (novembre 1976), coll. « Pocket », trad. de l’italien par Martine Schruoffeneger, 320 p., 7 €.