La rentrée littéraire 2020 a livré une myriade d’œuvres d’autrices remarquables. Dans Trencadis, Caroline Deyns assemble la matière-vie de la plasticienne, peintre et sculptrice franco-américaine Niki de Saint Phalle. À la faveur de pièces taillées dans la chair. Les chairs à vif. Le vif d’une enfance marquée par un crime sexuel. Un romangraphie sépulcral, magnifique et magnétique, hommage à l’émancipation des femmes et à la puissance salvatrice de l’art.
 L’histoire de Niki de Saint Phalle commence comme un conte de fée, sang noble, parents argentés, éducation new-yorkaise et explose en début de route dans un marécage de stupre sordide. En effet, des prédateurs se sont cachés dans l’arbre généalogique de l’artiste. À commencer par Gil de Rais premier criminel en série avéré dont elle écrira par superposition masculine tutélaire : «Il y a lui et il y a moi tout le reste, ça compte pas». Son père, André Marie Fal de Saint-Phalle, qui viole les femmes de son entourage, ses filles comprises. Sa mère enfin, Jeanne-Jacqueline Harper qui use de violence physique sur ses enfants pour se venger de l’infidélité de son mari.
L’histoire de Niki de Saint Phalle commence comme un conte de fée, sang noble, parents argentés, éducation new-yorkaise et explose en début de route dans un marécage de stupre sordide. En effet, des prédateurs se sont cachés dans l’arbre généalogique de l’artiste. À commencer par Gil de Rais premier criminel en série avéré dont elle écrira par superposition masculine tutélaire : «Il y a lui et il y a moi tout le reste, ça compte pas». Son père, André Marie Fal de Saint-Phalle, qui viole les femmes de son entourage, ses filles comprises. Sa mère enfin, Jeanne-Jacqueline Harper qui use de violence physique sur ses enfants pour se venger de l’infidélité de son mari.
« J’ai commencé à peindre chez les fous. J’y ai découvert l’univers sombre de la folie et sa guérison, j’y ai appris à traduire en peinture mes sentiments, les peurs, la violence, l’espoir et la joie. »
 Dès lors, Niki de Saint Phalle survit avec des serpents phalliques dans la tête, du venin auto-destructeur dans les veines et un corps frêle à la beauté épineuse mordu au sang. Sa douleur s’inscrit dans des dépressions à répétition et des maladies multiples. Le poison paternel coule sous l’épiderme d’une existence-œuvre. Un séjour en hôpital psychiatrique lui relève la création, sa planche de salut. Jeune mère, elle abandonne ses deux enfants et son mari l’écrivain Harry Matthiews pour l’art. Elle peint, sculpte, découpe, colle, modèle, régurgite, respire, aime, jouit dans son creuset émancipateur. Chaque geste fécond la nourrit en rondeurs monumentales et couleurs vives à l’image de la célèbre série des Nanas. Féministe avant l’heure, elle tire à la carabine dans le patriarcat, fusille les modèles familiaux traditionnels, pointe ses armes sur la morale et les conventions. Femme libre. Libre d’amour charnel. Avec le sculpteur métallique Jean Tinguely. Jusqu’à leur mort.
Dès lors, Niki de Saint Phalle survit avec des serpents phalliques dans la tête, du venin auto-destructeur dans les veines et un corps frêle à la beauté épineuse mordu au sang. Sa douleur s’inscrit dans des dépressions à répétition et des maladies multiples. Le poison paternel coule sous l’épiderme d’une existence-œuvre. Un séjour en hôpital psychiatrique lui relève la création, sa planche de salut. Jeune mère, elle abandonne ses deux enfants et son mari l’écrivain Harry Matthiews pour l’art. Elle peint, sculpte, découpe, colle, modèle, régurgite, respire, aime, jouit dans son creuset émancipateur. Chaque geste fécond la nourrit en rondeurs monumentales et couleurs vives à l’image de la célèbre série des Nanas. Féministe avant l’heure, elle tire à la carabine dans le patriarcat, fusille les modèles familiaux traditionnels, pointe ses armes sur la morale et les conventions. Femme libre. Libre d’amour charnel. Avec le sculpteur métallique Jean Tinguely. Jusqu’à leur mort.
« Les couleurs sont en réalité des tristesses noires qui se griment en arlequin pour s’assurer qu’on ne les reconnaissent pas : un désespoir qui voudrait passer incognito. »
 Caroline Deyns élabore sa mosaïque littéraire à la faveur de déclarations de Niki de Saint Phalle, de citations d’autrices et d’auteurs, de calligrammes, d’interviews de son entourage, de récits au présent. L’autrice ne s’impose pas de contraintes liées au genre biographique. Elle ne donne pas tant à voir le parcours de l’artiste qu’à rendre saillante la chair d’une héroïne romanesque sous l’épiderme du quotidien « J’ai décidé très tôt d’être une héroïne, l’important était que ce fut difficile, grand, excitant ». Filer les nuits-démence et les jours-liesse, fixer les rires exubérants et les hurlements intestins, crocheter les gestes cathartiques sublimatoires, coller les écailles de la vie peau de serpent. Ses plis lisses, ses replis rugueux, ses coutures dorées, ses déchirures béantes, ses aiguilles incandescentes et ses points de croix. L’écriture de Caroline Deyns agit comme une machine à coudre gigantale dont le cliquetis hypnotique résonne encore longtemps après la dernière page.
Caroline Deyns élabore sa mosaïque littéraire à la faveur de déclarations de Niki de Saint Phalle, de citations d’autrices et d’auteurs, de calligrammes, d’interviews de son entourage, de récits au présent. L’autrice ne s’impose pas de contraintes liées au genre biographique. Elle ne donne pas tant à voir le parcours de l’artiste qu’à rendre saillante la chair d’une héroïne romanesque sous l’épiderme du quotidien « J’ai décidé très tôt d’être une héroïne, l’important était que ce fut difficile, grand, excitant ». Filer les nuits-démence et les jours-liesse, fixer les rires exubérants et les hurlements intestins, crocheter les gestes cathartiques sublimatoires, coller les écailles de la vie peau de serpent. Ses plis lisses, ses replis rugueux, ses coutures dorées, ses déchirures béantes, ses aiguilles incandescentes et ses points de croix. L’écriture de Caroline Deyns agit comme une machine à coudre gigantale dont le cliquetis hypnotique résonne encore longtemps après la dernière page.
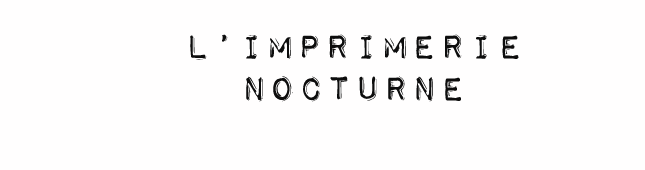







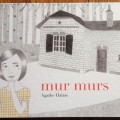









Je ne connais pas Karine Baudot mais qu’elle soit remercié vivement. Une recension pareille justifie tous les efforts fournis à partir de la création de Caroline Deyns. Son ressenti est au cœur même du roman. Avec gratitude.