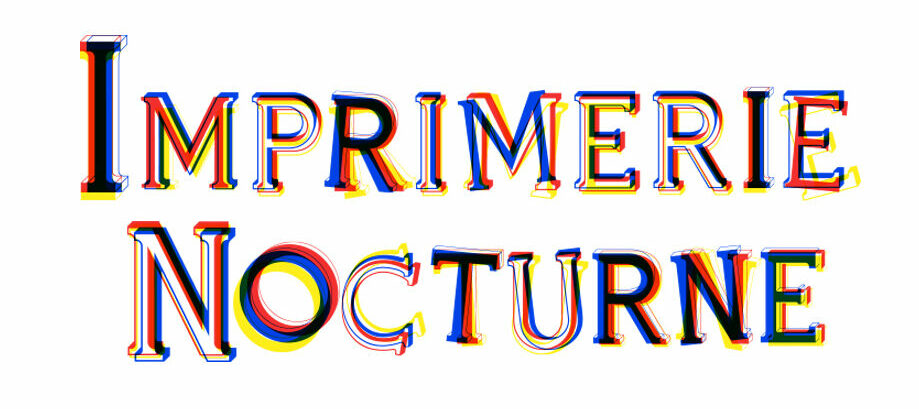Poursuivant une carrière longue de plus de 60 ans devant la caméra, et presque 50 ans derrière, le grand Clint revient dans nos salles avec The Mule, film intime aux accents de flamboyant western classique. On y suit les allers-retours d’Earl Stone, horticulteur nonagénaire et vétéran de la guerre de Corée, devenu convoyeur de cocaïne pour le cartel de Sinaloa après que son entreprise ait dû déposer le bilan. Épopée crépusculaire contre les narcos ? Pas vraiment.
Ce serait méconnaître gravement le cinéaste que de s’attendre à une charge frontale contre l’Amérique libérale, façon Money Monster, au moins autant que de vouloir coller son discours sur un bord ou l’autre du spectre politique (particulièrement en France), le plaçant dans le camp des « bons » ou des « mauvais », comme d’aucuns l’ont si souvent fait. La philosophie libertarienne de Eastwood (essentiellement « Foutez-moi la paix, je vous laisserai tranquille aussi ») ressort tout au long de sa filmographie, particulièrement lorsqu’il se met lui-même en scène. Il aborde avant tout son cinéma pour les questions qu’il pose, et se garde bien de donner une réponse péremptoire.
Tout à la fois Josey Wales et William Munny dans Impitoyable, Eastwood est le cinéaste de l’ambiguïté, particulièrement lorsqu’il se met en scène. Tout à fait conscient de l’image de facho qui lui colle au cou depuis L’inspecteur Harry (1971), il continue à jouer avec les spectateurs en incarnant des personnages à la moralité parfois trouble, ou plus simplement tenant des propos vieux-jeu. Ceci essentiellement parce que lui sait ne pas être ce facho-misogyne-raciste-patriote-à-l’extrême que certains se plaisent à dépeindre, et se sert donc de ses personnages pour ce qu’ils sont : des personnages. Il fait ainsi en quelque sorte le tri entre ceux qui voient ses films et le connaissent lui, en tant qu’auteur, et ceux qui ne s’en tiennent qu’aux apparences. Tout au long du film, son personnage, Earl Stone, assiste quelques personnes qu’il croise sur la route, et commet parfois des maladresses. « Negro, chicano, etc. ». Quand on le corrige, il répond simplement « Oh, ok, désolé », avec un sourire. Eastwood a pleinement conscience que ceux qui le connaissent savent que sur le tournage de Chasseur blanc, Cœur noir, il a viré en deux secondes le premier technicien qui tenait des propos racistes à un habitant du coin. Pour lui, qu’importe le « qu’en dira-t-on. »
Dans The Mule, on voit aussi Earl perdre sa petite entreprise, ne pouvant rivaliser avec la concurrence des consortiums et leurs magasins en ligne. Il se tourne vers le crime pour aider au mariage de sa petite-fille, pris à la gorge par les dettes. Plus tard, il la supporte financièrement pour ses études, toujours grâce à l’argent des convois. Sauf quelques détails, son incursion dans le cartel est d’ailleurs présentée comme un simple boulot. Il fait ses allers-retours tranquillement, commence vite à sympathiser avec ses collègues, au sein de ce qui est filmé comme un business familial. Plus tard, en revanche, un nouveau management reprend les affaires. Earl ne peut alors plus faire ses pauses sur la route, ou rouler à son rythme. Le rapport avec le cartel change radicalement, et ses membres représentent soudainement une réelle menace physique, ce qu’Eastwood signifie en changeant radicalement sa façon de les filmer. Le point de vue sur le travail est plutôt clair.
Si le propos politique a toujours été important dans l’œuvre du grand Clint, The Mule nous en dit tout autant sur sa vision de l’intime et du cercle familial. Comme il nous le dit souvent dans ses films, de Sur la route de Madison à Gran Torino, en passant par Un Monde parfait, il est capital de ne pas perdre de vue ce qui compte réellement, et il n’est jamais trop tard pour corriger le tir. Earl Stone, passant plus de temps sur la route dans sa voiture que chez lui, est finalement complètement déconnecté de sa famille. Sa fille refuse de lui adresser la parole car il a toujours été absent pour elle et a manqué son mariage, ce pour quoi son ex-femme lui en veut énormément aussi. L’Amérique de la libre concurrence et des vétérans laissés-pour-compte tient office de décor, mais c’est bien l’histoire d’un homme qui tente de recréer des liens avec sa famille qu’on nous raconte.
Preuve magistrale de la force première du cinéma d’Eastwood, la direction d’acteurs, le film brille par la constance de son interprétation, des têtes d’affiches aux seconds rôles. Comme toujours très sobre, la réalisation dépeint magnifiquement ce récit intime. Jamais dans la surenchère, elle est fonctionnelle et sert l’histoire, point. L’économie d’effets de manche narratifs ou stylistiques est une marque de son cinéma, et elle renforce ici le drame que traversent les personnages. Le réalisateur ne s’autorise à sortir de cette contrainte que parfois, pour les scènes de routes, véritables morceaux d’americana, laissant la caméra couvrir les étendues infinies des États-Unis sur une bande-son constituée de standards jazz et rock.
Délivrant ici un film d’une élégance rare, sans effet formel tapageur, juste au service de son histoire, Eastwood signe un grand retour en force, après l’échec artistique de 15h17 pour Paris. Joie de le retrouver devant la caméra, où il livre une performance extraordinaire, et derrière, où il semble plus inspiré que jamais. The Mule est un grand film d’Eastwood, qui réconciliera sûrement de nombreuses personnes avec son cinéma. C’est encore en salle, et il faut impérativement en profiter.