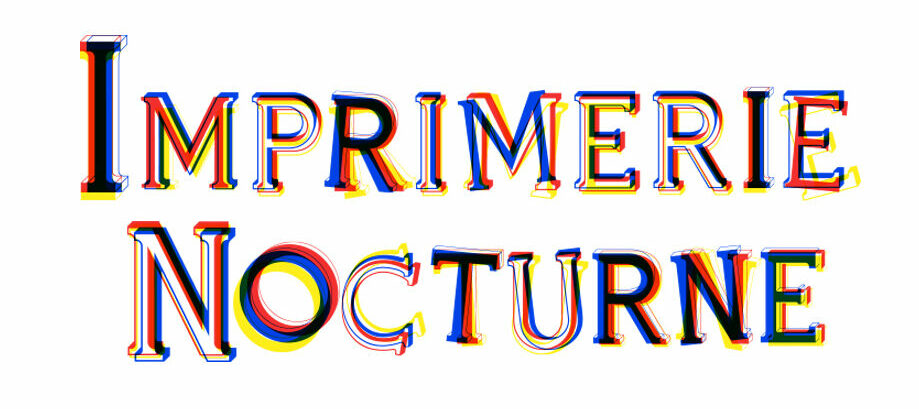Samedi 14 janvier, le ciel lourd de Still Life, pièce de théâtre du chorégraphe et metteur en scène grec Dimitris Papaioannou, envoûtait le regard des spectateurs, au TNB pour sa dernière représentation à Rennes.
Dimitris Papaioannou n’en est pas à sa première poésie. Avant de peindre la scène, il s’est essayé à la toile et à la bande-dessinée. Étudiant de l’école des Beaux-Arts d’Athènes, il y côtoie le peintre grec Yannis Tsarouchis. Puis, à New-York, il deviendra apprenti danseur sous la houlette d’Eric Hawkins et du chorégraphe butôt, Min Tanaka. De retour en Grèce, il fonde la troupe de théâtre Edafos Dance Theater, influençant grandement le théâtre contemporain grec. C’est en 2001 que la commission d’organisation des Jeux Olympiques fera appel à lui pour mettre en scène les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’Athènes de 2004. Production à la démesure digne d’un blockbuster hollywoodien, il apprivoise les dieux et déterre les héros et mythes grecs.
« La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme »
Dix ans plus tard, Still Life, enfant bien plus modeste et simple, se joue à guichet fermé au centre culturel Onassis, puis au Piraeus Theatre. « En 2013, moment où la Grèce entrait dans une crise profonde, j’ai décidé de revenir à une grande économie en utilisant des matériaux ordinaires. Minimum de moyens, maximum de poésie. C’est la tristesse et la dépression partout et, pourtant, tout continue, mais c’est vraiment triste. »
Still Life, c’est un constat amer et pourtant chargé d’un espoir fou, c’est-à-dire humain. C’est celui de Sisyphe, ce « héros de la classe ouvrière » comme le dit Dimitris Papaioannou. Ce Sisyphe que nous portons tous en nous, le Sisyphe de Camus. Plus encore que la condamnation divine de ce pauvre bougre de Sisyphe à devoir faire rouler éternellement jusqu’en haut d’une colline, un rocher sans jamais y parvenir, Still Life s’attache à cette citation d’Albert Camus « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme ».
Still Life, tant qu’il y a de la vie…
Un homme s’avance au devant de la scène. Lourdement. Il porte sur son dos un matelas recouvert de plâtre. Le bruit de ses pas se confond avec l’effritement de ce « mur souple ».
Dans les hauteurs, un voile délicat et transparent se remplit d’une fumée lourde. Le ciel prend vie.
Dans un jeu de mise en tension et d’équilibre, s’ensuit une lutte avec ce mur tombant en ruine à mesure des coups qui lui sont portés. Mur matriciel d’où surgissent de nouveaux corps, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, se pourchassant à travers lui. Jouant sur le visible et l’invisible, les corps se recréent dans de multiples variations de positions, bien souvent comiques, parfois monstrueuses. Mais jamais l’Invisible, celui qui se raconte derrière le mur, ne leur sera connu malgré leurs multiples tentatives.
Still Life gratte les sens. Nul besoin de décors réalistes, la partition sonore suffit à vous emmener dans cette terre aride, minérale et venteuse où rien ne semble pouvoir naître si ce n’est la poussière. Et pourtant, c’est une terre que les Hommes s’affairent à travailler le dos courbé et aveugles à l’horizon, à retourner encore et encore, semblant chercher ainsi un sens à leur vie laborieuse.
Et ce ciel toujours plus bas, toujours plus gonflé de leurs espoirs absurdes. Ce ciel qui finit par leur marcher sur la tête. Et, alors que le soleil disparaît, ces héros modernes prennent place autour d’une table pour y partager un repas convivial, avant de reprendre leur masque de Sisyphe.
Certes, « la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme » mais ce cœur sera d’autant plus rempli qu’il le partage avec d’autres.
Samedi 14 janvier, j’ai cru qu’enfin, il était possible à l’homme d’atteindre l’impossible, de toucher le ciel et de s’emparer du soleil. Mais même au théâtre, cela n’est pas le cas. J’imagine que ça ne doit être que réservé aux dieux…