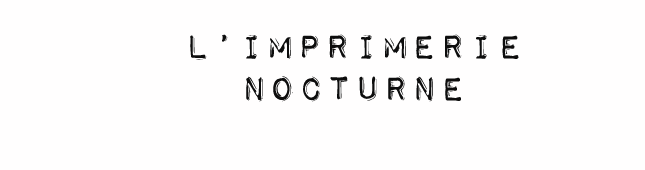Qui aujourd’hui n’a pas entendu parler de Caryl Férey, ou de Zulu, son best-seller, ou encore de Mapuche ? Cet auteur de polars à succès, a publié, il y a un an maintenant, Comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale. Il y raconte la manière dont il est devenu écrivain, ses déboires, ses déceptions, ses cuites, ses remises de prix, complètement pinté… Il y raconte la route qui l’a mené à écrire Zulu et à taper dans l’œil de Gallimard, lui, né à Montfort-sur-Meu, ancien barman et jeune pilier, comme nous autres, dans notre bonne vieille ville de Rennes.
 Dans ce petit roman autobiographique, Férey choisit la forme spontanée, la langue rock, la virulence et l’humour cinglant. Premier chapitre, pas de point, qu’on aime ou qu’on n’aime pas, ça claque, ça envoie direct, pas le temps de respirer, on halète sévère, il débite ses souvenirs comme on se souvient, il frappe fort sur les rapports fraternels qu’il entretient avec son aîné. Voilà, le rythme et le ton sont donnés, le récit peut commencer. On remet des points dès le chapitre suivant, mais on ne ralentit pas pour autant, la fulgurance est introduite d’une belle manière.
Dans ce petit roman autobiographique, Férey choisit la forme spontanée, la langue rock, la virulence et l’humour cinglant. Premier chapitre, pas de point, qu’on aime ou qu’on n’aime pas, ça claque, ça envoie direct, pas le temps de respirer, on halète sévère, il débite ses souvenirs comme on se souvient, il frappe fort sur les rapports fraternels qu’il entretient avec son aîné. Voilà, le rythme et le ton sont donnés, le récit peut commencer. On remet des points dès le chapitre suivant, mais on ne ralentit pas pour autant, la fulgurance est introduite d’une belle manière.
Une écriture superbement maîtrisée
Ce qui touche, au-delà d’une écriture superbement maîtrisée, je dirais même plus d’un style bien établi, c’est le récit en lui-même. L’histoire d’un gars comme nous, excité, fougueux, idéaliste, qui écume les bars de la capitale bretonne, comme tout bon Rennais. L’histoire d’un mec… banal, quoique bien décidé à écrire… En lisant les pages, avec la même fougue que celui qui les a écrites, on voit les rues pavées, on entend presque les gars de Sainte-Anne gueuler, passé minuit, on s’imagine Rennes dans les années 90 alors que les mecs comme moi mangeaient encore de la Vache qui Rit devant Père Castor, on s’imagine vingt ans plus tôt, la même ville, le Chien Jaune, le même ciel, les mêmes âmes révoltées, les mêmes coudes usées, les mêmes rires et parmi la foule des blousons de cuir noir à la mode de la fin des années 80, Caryl Férey…
Tout au long des pages et des touches piquantes qu’il lance à droite à gauche pour étancher des rancœurs, le voilà qui évolue, qui s’envole pour la Nouvelle-Zélande, puis Paris, qui enchaine les petits boulots, qui écrit, toujours, écrit encore, qui squatte chez des potes… Des pages qui ne se lâchent pas comme ça, du genre à se lire avec les yeux qui brûlent de fatigue mais ne peuvent se fermer, avec la tête chaude et la bouche qui salive à l’idée d’aller s’en prendre une petite avec le fameux Caryl. Une petite bière.
Un bémol. Un seul, un tout petit. On sent la verve, la passion dans chacun des mots, mais si le récit dans son ensemble est franc, il manque pourtant d’une certaine sincérité. Il survole parfois les sentiments pour rester dans du brut, juste pour du brut. On aimerait peut-être ici le voir se dévoiler, mais ça n’est jamais le cas. Ou alors, il le fait avec un humour et un ton sarcastique qui masque quelque chose qu’il semble ne pas vouloir écrire… Ressenti purement personnel, qui n’enlève cependant rien à la qualité du bouquin.
Les mots sont justes, toujours, pas un de travers, pas une phrase non-maîtrisée
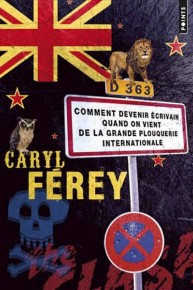 Beau boulot. On pourrait presque croire que le type qui dit mettre 2 à 3 ans pour écrire ses romans, a mis une nuit pour écrire celui-ci, tant le tout est cohérent dans sa forme spontanée. Comme s’il avait débité ses souvenirs comme un dératé, plié en deux sur son ordi, clope au bec et tout le rituel cliché qu’on peut s’imaginer… quel boulot, je répète, quel boulot. Les mots sont justes, toujours, pas un de travers, pas une phrase non-maîtrisée, le rythme qui colle au récit, tantôt vif, court, taillé au millimètre, tantôt en longueur qui essouffle pour faire haleter le lecteur. On a passé la nuit assis dans le lit, sur le dos, sur le côté, toujours le livre dans les mains, et quelques heures plus tard, on claque le bouquin, terminé, basta… on a les yeux rouges, plus du tout envie de dormir, quelques fourmis dans la main gauche, plus du tout envie de dormir, on se dit « putain quand même, le salaud, c’est bon ce qu’il a écrit, c’est bon, le salaud ».
Beau boulot. On pourrait presque croire que le type qui dit mettre 2 à 3 ans pour écrire ses romans, a mis une nuit pour écrire celui-ci, tant le tout est cohérent dans sa forme spontanée. Comme s’il avait débité ses souvenirs comme un dératé, plié en deux sur son ordi, clope au bec et tout le rituel cliché qu’on peut s’imaginer… quel boulot, je répète, quel boulot. Les mots sont justes, toujours, pas un de travers, pas une phrase non-maîtrisée, le rythme qui colle au récit, tantôt vif, court, taillé au millimètre, tantôt en longueur qui essouffle pour faire haleter le lecteur. On a passé la nuit assis dans le lit, sur le dos, sur le côté, toujours le livre dans les mains, et quelques heures plus tard, on claque le bouquin, terminé, basta… on a les yeux rouges, plus du tout envie de dormir, quelques fourmis dans la main gauche, plus du tout envie de dormir, on se dit « putain quand même, le salaud, c’est bon ce qu’il a écrit, c’est bon, le salaud ».