Isabella Hammad, Reconnaître l’étranger – La Palestine et le récit : le souhait ardent de nouveaux chapitres qui ne seraient pas dominés par des monstres sanguinaires.
Rédigé en 3 temps (septembre 2023, novembre 2023, mai 2025), cet opuscule est la retranscription d’une conférence donnée par l’auteure, Isabella Hammad, romancière anglo-palestinienne, à l’université de Columbia, le 28 septembre 2023 dans le cadre du Edward W. Said Memorial.
« Jusqu’à une date récente, la Palestine avait quasiment disparu de la sphère diplomatique dans un marigot de négociations de paix ratées sous la houlette des États-Unis, pendant que les forces néolibérales et celles de la droite dure repoussaient la gauche progressiste dans le monde entier. Dans le même temps, malgré tout, la question de la Palestine continue de préoccuper la plus grande part de cette gauche ; de plus en plus de gens prennent conscience des réalités de la politique colonialiste et de la purification ethnique, du caractère ethnocentriste et expansionniste de l’idéologie sioniste ; ils s’aperçoivent que des instants de reconnaissance individuelle sont jour après jour submergés par une élite politique qui martèle au témoin : les apparences sont trompeuses, c’est trop compliqué à comprendre, n’essayez pas d’y voir clair. » (p. 17)
Isabella Hammad s’intéresse à l’écriture et à ces moments, dans la littérature comme dans la vie citoyenne, au cours du récit aussi bien que dans le cours de la vie quotidienne, où s’opèrent des reconnaissances, où se dévoilent des vérités, où les choses se révèlent et revêtent alors une autre signification. Isabella Hammad souligne l’importance de ces moments cruciaux, lorsque le déni cesse. Les masques tombent. Il devient impossible de cacher ou nier certaines choses. Un nouveau sens apparaît, permettant à l’Histoire de bifurquer et au réel d’être donc appréhendé d’une façon radicalement différente. La géopolitique et la question palestinienne – et celle des oppressions en général – évidemment s’invitent dans cette conférence. Comment imaginer que ce ne soit pas le cas ?
« De nombreux Palestiniens ont néanmoins consacré leur vie et leur carrière à tenter de susciter ces épiphanies [lorsqu’un soldat israélien, comme le Daniel cité en exemple que rencontre l’auteure, avoue se rendre compte des crimes qu’on lui demande de commettre sous l’uniforme de Tsahal], mais en général, ceux qu’ils tentent de persuader ne sont pas des soldats, car exception faite de la toute petite minorité qui “rompt le silence” via les canaux domestiques et conteste parfois la propagande de l’État et l’idéologie suprémaciste sioniste, les soldats se contentent de reproduire cette même propagande et cette même idéologie. Ils constituent d’ailleurs une courroie de transmission majeure de l’une comme de l’autre. L’idée qu’on puisse persuader par le dialogue des Juifs israéliens dans leur ensemble de voir les Palestiniens comme des êtres humains est absurde puisqu’ils vivent dans une société militarisée où la dissidence expose à des sanctions. » (p. 20)
Dans les situations désespérantes, on ne peut qu’aspirer à ces prises de conscience, à ces reconnaissances. L’Histoire nous apprend qu’elles ont lieu, surgissent au bout du compte. « Le fait est que des édifices bougent dans l’histoire, nous rappelle l’auteure. Des empires sont tombés, le mur de Berlin est tombé, l’apartheid est tombé en Afrique du Sud, et même si, dans un cas comme dans l’autre, ces conclusions supposées n’ont pas signifié la fin de l’histoire, elles autorisent quand même à penser qu’en unissant les forces locales et internationales dans l’action, l’apartheid israélien aura une fin, lui aussi. Toute la question est de savoir quand et comment. En quel point du récit nous trouvons-nous aujourd’hui ? » (page 35)
« Le déni (…) c’est le contraire absolu de la reconnaissance. (…) Ainsi des propriétaires d’esclaves et économistes du XIXᵉ siècle affirmant que mettre fin à la servitude des hommes n’est pas viable économiquement ou politiquement. Les convictions qu’ils défendent farouchement font penser aux arguments du lobby des armes à feu, à ceux des gouvernements concernant les énergies fossiles et à ceux qui prétendent que sanctionner les puissances occupantes sur la base de leurs crimes contre l’humanité relève de l’impossible. Nous avons vu sans équivoque, tout récemment, qu’il n’en est rien. Dans la crise climatique, les moments que nous vivons aujourd’hui ou avons vécu récemment, seront perçus comme des tournants le jour où nous serons de plus en plus nombreux à reconnaître que nous traitons la terre comme une esclave, et que son exploitation est profondément contraire à l’éthique. Reste à trouver un langage neuf pour cette éthique. » (pages 35-36)
Concernant ce drame qui dure, cette « épuration ethnique à grande échelle » (p. 48), en Palestine et dans les territoires occupés par l’État d’Israël, et qui a démarré bien longtemps avant l’offensive désespérée des forces armées palestiniennes en octobre 2023, l’auteure s’interroge et s’inquiète. « Le reste de la planète va-t-il le laisser faire ? Ou bien Gaza a-t-il déclenché un changement dans l’ordre du monde dans la mesure où les peuples qui vivent dans les pays qui s’intitulent démocraties comptent désormais avec la Palestine. À moins que nous soyons en train de capituler face à un consensus délétère, pour cause de fragilité des principes démocratiques de base et du droit international ? Quelque part, récemment, l’humanité semble avoir franchi une ligne invisible, et le pouvoir brut associé à la volonté de profit menacent de submerger les intérêts collectifs de notre espèce. » (« Postface : Gaza », novembre 2023, p. 49). Le post-scriptum, en date de mai 2025, qui prend acte de ce premier génocide de l’histoire « à être filmé et célébré si allègrement par ses auteurs » (p. 55) n’est pas beaucoup plus rassurant. Nonobstant, l’Histoire est encore à écrire – et ce n’est pas l’équipe de l’Imprimerie Nocturne chargée des horoscopes qui prétendra le contraire. Les prochains chapitres apporteront nécessairement leur lot de surprises, de changements salutaires, de prises de conscience et de combats politiques. Ou poétiques.
[box]Isabella Hammad, Reconnaître l’étranger – La Palestine et le récit, coll. « Tracts », Gallimard, n° 70, 62 pages, septembre 2025, 3,90 €.
[/box]
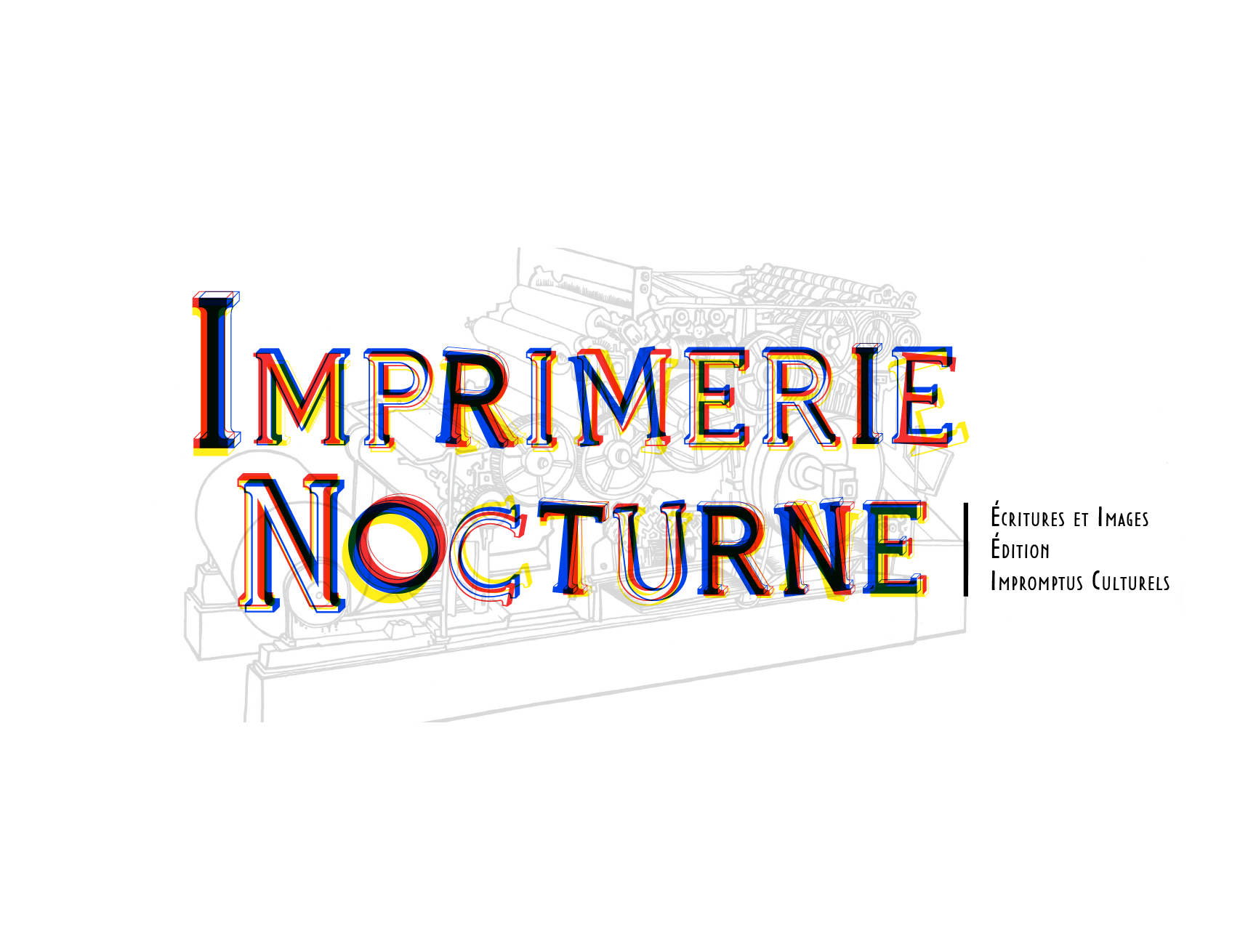
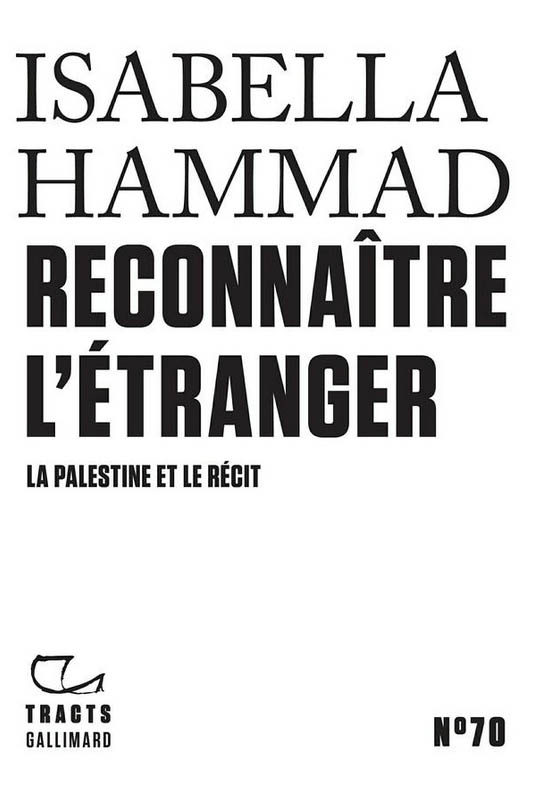
3 réponses à “Isabella Hammad, Reconnaître l’étranger – La Palestine et le récit”
https://shorturl.fm/HnJwp
https://shorturl.fm/QPI2z
https://shorturl.fm/VodJ8