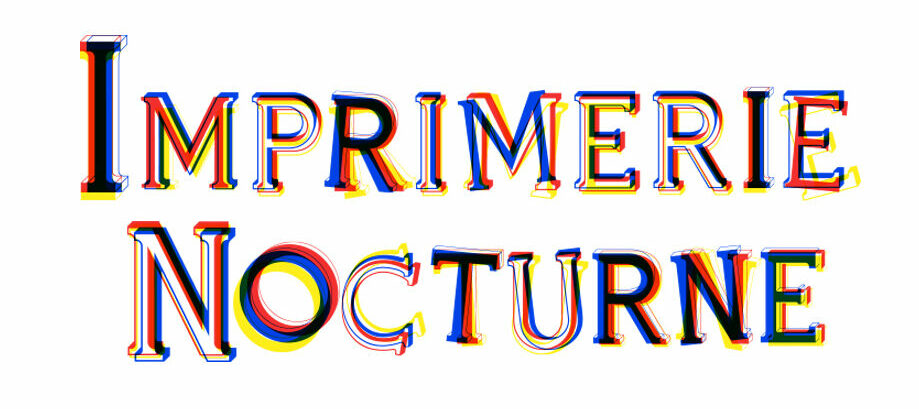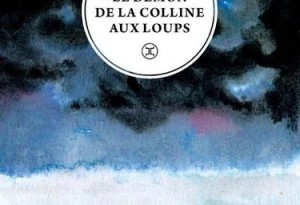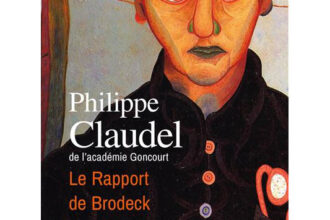À l’occasion de la quinzième édition du festival littéraire Rue des livres qui se déroulera les 12 et 13 mars, focus sur des romans d’auteurs et autrices invité·es. On commence avec Mauvais départ de Liza Kerivel. Récit-hommage féministe de l’autrice à sa grand-mère sardinière à Douarnenez. Tissé avec acuité comme les mailles d’un filet qui enferme les femmes du 20ᵉ siècle dans les renoncements sociaux-patriarcaux. Dans un souffle poétique documenté qui restitue parole et identité. Une complainte d’ouvrières à la langue-crabe entre résignation, colère et plaie à vif.
Écoutez l’ bruit d’ leurs sabots
Voilà les ouvrières d’usine,
Écoutez l’ bruit d’ leurs sabots
Voilà qu’arrivent les Penn Sardin
« Chanson des Penn sardin » / Claude Michel
Écoutez Liza Kerivel ramender les mailles du passé de sa grand-mère. Mémé qui habite dans les souvenirs d’enfance de l’autrice une maison de bout de terre décapée à l’eau de Javel. Mémé à la peau douce aux fragrances d’eau de Cologne en chandail et savates. Mémé qui « fait tout vite, qui cuisine des lichouseries, qui agite ses mains telle une marionnette ». Mémé qui exprime ses regrets à l’âge des peaux tannées, à l’âge où les colères remontent, à l’âge d’exhausser ses désirs ultimes. Ce n’était pas si loin l’Amérique. Ce n’était pas si loin l’absence du regard des autres.
Jamais je n’ai vu mémé aller à la plage… La mer ne la concernait pas. C’était un truc de marins. Peut-être même un truc d’hommes. Elle n’aimait pas la mer. Pour aimer la mer, pour passer des heures à la regarder en s’étonnant de ses reflets, il faut avoir de bonnes raisons. Il ne faut pas qu’elle nous ait fait pleurer trop souvent. (p. 84)
Écoutez le récit de mémé, Marie Coïc, Finistérienne pur beurre demi-sel. Marie Coïc « née en 1921 au Guilvinec dans les décombres de la misère et de la Première Guerre mondiale ». En pays bigouden. Marie Coïc, sardinière à 13 ans. Un peu à Quiberon, à Croix-de-Vie, à Saint-Jean-de-Luz, souvent les étés à Pornic, surtout à Douarnenez. Marie Coïc qui ne voulait pas se marier, avoir d’enfant et porter la coiffe. Écoutez le récit des renoncements de Marie Coïc devenue Marie Kerivel.
La peur de mal faire s’est inscrite précocement dans son corps de petite fille. La peur de ne pas être aimée, la peur d’être indigne, la peur d’être jugée, la peur que l’on croie les Konchenn racontés sur elles. Ces peurs ne l’ont plus jamais quittée. Elle a toujours eu honte et peur d’avoir honte. Une honte vitale, une honte sociale qui s’est construite tout au long de son existence, dans l’histoire des discriminations qu’elle a subies et des renoncements auxquels elle a dû faire face. (p. 36)
Écoutez tourner les pages de l’album-photo d’une famille bretonne de marins-pêcheurs, au rythme des saisons qui suivent le courant des poissons, qui suivent les écailles des peaux de femmes domestiquées, qui suivent les entailles à leur épanouissement personnel. Les photos en noir et blanc puis en couleur d’une fillette aux côtés de Bigoudènes « tout en larmes et en colères », les photos d’un mariage finalement consenti pour cause de siècle qui enrôle les femmes à perpétuité dans des costumes d’épouse et de mère, la bague au doigt, la coiffe sur la tête, les pieds et les poings liés, le cœur lourd.
En se mariant avec ce marin, elle sait forcément qu’elle est en train d’épouser le monde qui va avec. La solitude, la maternité, la pauvreté, l’incertitude, la pêche, le bistrot. Bien sûr qu’elle sait. « Femme de marin, femme de chagrin, non ? »
Écoutez les mauvais départs de Marie Coïc (et de sa petite-fille) parce que femme(s) trop libre ou trop fragile, touche-à-tout, pas sage. De Marie Coïc adolescente immergée dans le silence. De Marie Coïc qui comprend très jeune qu’il n’y a pas d’âge pour survivre et que tenir debout constitue le seul l’horizon. Ne subsiste alors que que les arêtes de ses rêves. Remplacées par la honte quand la volonté de parler breton se solde par un échec.
À l’école, et même s’il n’existe aucune loi écrite, les enfants se doivent de parler français. Si un élève prononce par mégarde un mot breton, il doit porter un « symbole ». Ce symbole, on l’appelle « vache ». C’est un galet, un bout de bois, des sabots, peu importe. Dans la cours de récréation, l’enfant qui porte un symbole devient la bête noire. Il ne peut s’en libérer que s’il dénonce un autre enfant ayant à son tour prononcé un mot breton. S’il n’a pas réussi à la fin de la journée, il est définitivement puni, balaie la cours, se prend des coups de règles sur le bout des doigts ou écrit une dizaine de fois « je ne parlerai plus breton». (p. 35)
Écoutez l’intime crocheté à la grande histoire. La grève des sardinières, le Front populaire, la Seconde Guerre mondiale, la Libération, le premier vote des femmes, l’élection de François Mitterrand, la consécration de la société de consommation, l’évolution de la pêche et des modes de vie. Le quotidien de Marie Coïc suit de loin les changements d’un siècle qui a fatigué son corps à force d’en faire don à son entourage sans répit, sans temps pour elle.
C’est une vie tout entière de croyances et de superstitions. Les évènements arrivent sans prévenir. Le malheur surgit d’un coup. Les grossesses tombent mal. La mort n’est jamais très loin. (p. 50)
Écoutez souffler le vent de Douarnenez, ville aux trois ports. Son antagonisme d’autrefois avec Tréboul où habitent Marie Kerivel et son mari. Douarnenez, ville-ouvrière populaire aux conserveries-fourmilières. Douarnenez, ville-fronde, ville-femmes. Dans le sillage de Joséphine Pencalet, une des premières élues conseillère municipale en 1925. Femmes de marins. Femmes de patrons-pêcheurs. Femmes veuves. Femmes bistrotières. Femmes de mauvaises vie. Femmes brisées. Femmes de rien qui n’existent pas socialement.
Toutes les femmes ne sont pas des Pencalet. D’ailleurs « les femmes ça n’existent pas ; ça n’a jamais existé, ça n’existera jamais ». Les bourgeoises et les aristocrates, oui. Ces « dames », elles existent. Mais les autres femmes ? toutes les autres ? Celles du travail à l’usine, du travail saisonnier, de juin à septembre ou de mai à octobre . Celles des familles de trois, quatre ou cinq enfants où les aînées gèrent les plus petits ? Celles qui se rendent au lavoir, étalent leur linge sur l’herbe pour qu’il sèche puis s’assoient dessus pour repasser ? Ces femmes-là existent-elles vraiment ? (p. 31)
Écoutez les ouvrières d’usine, le bruit de leurs sabots dans les mots de Liza Kerivel. Écoutez le vent poétique des phrases courtes de l’autrice rendre à sa grand-mère une parole escamotée. Qui lui restitue son identité. Écoutez Marie Kerivel plus « muette que mouette » à cause d’une arête d’existence secondaire coincée dans la gorge. À la langue pourtant vigoureuse, imagée, directe. Le dialecte douarneniste qui « ne se laisse pas apprivoiser», qui « parle comme ça vient, parce que c’est ainsi que l’on a toujours vécu : simplement ». Parce que c’est ainsi que se lit Mauvais départ. Simplement. Dans la quête d’émancipation des femmes. Par le langage libérateur.