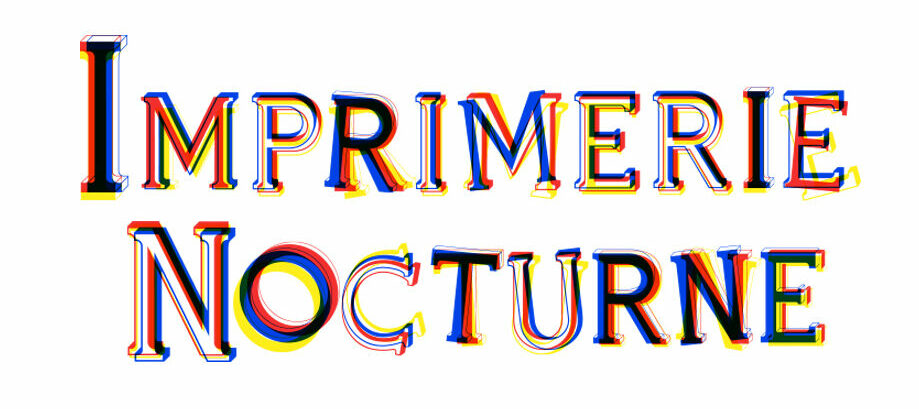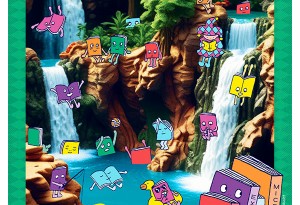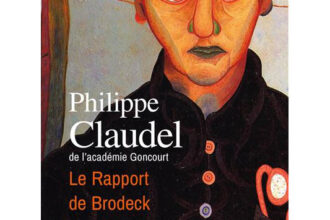Les logiques de la révolte – Bavures et émeutes de Vaulx-en-Velin à Nanterre, 40 ans d’histoire, par Alessio Motta : une humble tentative de comprendre le phénomène des émeutes faisant suite à des actions policières peu ou prou brouillonnes.
 Puisque Alessio Motta est docteur en science politique et expert en actions contestataires, on peut imaginer qu’il en connaît un rayon sur la question de la révolte – au moins autant que le boucher de Tourcoing en tout cas (auprès duquel Gérald Darmanin, qui ne perdrait pas son temps à lire ce fascicule, se vantait de prendre ses infos).
Puisque Alessio Motta est docteur en science politique et expert en actions contestataires, on peut imaginer qu’il en connaît un rayon sur la question de la révolte – au moins autant que le boucher de Tourcoing en tout cas (auprès duquel Gérald Darmanin, qui ne perdrait pas son temps à lire ce fascicule, se vantait de prendre ses infos).
En quoi la température et le temps libre influent sur le surgissement – ou non – d’une émeute ? À quel moment et en quels lieux ces émeutes – faisant généralement suite à des interactions houleuses avec la police, voire des bavures* éhontées ou des décisions gouvernementales impopulaires – surgissent-elles ? Quels rôles jouent les médias, le bouche-à-oreille et les réseaux d’information parallèles plus ou moins informels dans l’apparition historique, l’intensité et la durée des émeutes ? Quel est le public qui participe aux émeutes et comment celui-ci se coordonne-t-il ? Est-ce que la surenchère sécuritaire et policière est une garantie fiable pour contrecarrer les pulsions émeutières ?
Se basant sur une analyse rigoureuses d’émeutes répertoriées dans la banlieue lyonnaise dans les années 70 et 80, Alessio Motta nous apprend ainsi que les émeutes liées au violences policières sont une construction socio-médiatico-politico-culturelle. La jeunesse des quartiers où démarrent les émeutes n’est pas viscéralement violente ou portée à commettre des actes impulsifs de vandalisme ; mais un narratif a été mis en place au fil des dernières décennies qui scénarise le surgissement des émeutes après une bavure policière, faisant de l’émeute la réaction à laquelle médias, personnalités politiques et populations des quartiers s’attendent, rendant dès lors, dans un processus de prophétie auto-réalisatrice, l’émeute inéluctable.
Une foule de profils (animés par des ambitions variées et reflétant toute une gamme d’aspirations) participent aux émeutes. Il n’y a pas une nature – une essence – émeutière qui serait propre aux habitants des banlieues.
Les week-ends de beau temps sont également propices aux rassemblements émeutiers faisant suite à un « accident mortel impliquant la police » (p. 81), comme ce fut le cas en juin 2023 après la mort du jeune Nahel abattu à Nanterre par 2 policiers lors d’un contrôle routier.
Aucune formation axée sur les gestes d’apaisement et la désescalade n’est de surcroît assurée aux effectifs du maintien de l’ordre. Les rapports entre un gouvernement qui s’appuie de plus en plus sur sa police et a « un besoin vital des forces de l’ordre pour résister aux contestations » (p. 76) que ses réformes suscitent, et une police qui prend de plus en plus de liberté et d’autonomie, notamment depuis la loi Cazeneuve de 2017 assouplissant l’usage des armes à feu mises à sa disposition, sont de même particulièrement problématiques.
Mis bout à bout, ces éléments soulignent ainsi que la mécanique bavure / émeutes n’est pas près de s’enrayer – a fortiori tant que des bavures seront commises et que des discours politiques un peu moisis conduiront à considérer la jeunesse des quartiers populaires comme une faune sauvage ou un vil objet à réprimer. Face à ce problème sociétal d’ampleur, l’auteur n’a pas de solution clé en main. Il ne peut qu’esquisser des pistes de réflexion ou de réforme. Car pour qu’une situation s’améliore, encore faudra-t-il qu’il y ait, en haut-lieu, une réelle volonté politique de la changer.
« Un grand nombre de ces discours [moralisateurs et réacs] glorifient également la fermeté et l’autorité : “il y a des violences, renforçons encore et toujours la police, elle saura faire”. Or l’idée selon laquelle la police a trouvé la voie pour faire face efficacement aux grandes révoltes ne s’appuie sur aucun travail scientifique. Elle fait fi d’une réalité sidérante : plus les années passent, plus les gardiens de la paix interviennent armés et nombreux (600 en 1994, 11 000 en 2005, 45 000 en 2023)… et plus les dégâts sont importants. » (p. 86)
* L’auteur emploie le terme générique de « bavure » pour être compris de tous·tes, mais il précise dès l’introduction que « l’idée de la bavure ou du dérapage écarte la dimension systémique des violences policières [souligné par nous], c’est-à-dire le fait que la violence envers certains catégories de la population se trouve parfois normalisée ou encouragée dans une partie de l’institution policière » (p. 7).
[box]
Les logiques de la révolte – Bavures et émeutes de Vaulx-en-Velin à Nanterre, 40 ans d’histoire, par Alessio Motta, Éditions Matériologiques, Paris, 2024, coll. » Essais », 90 pages, 9 €.
[/box]