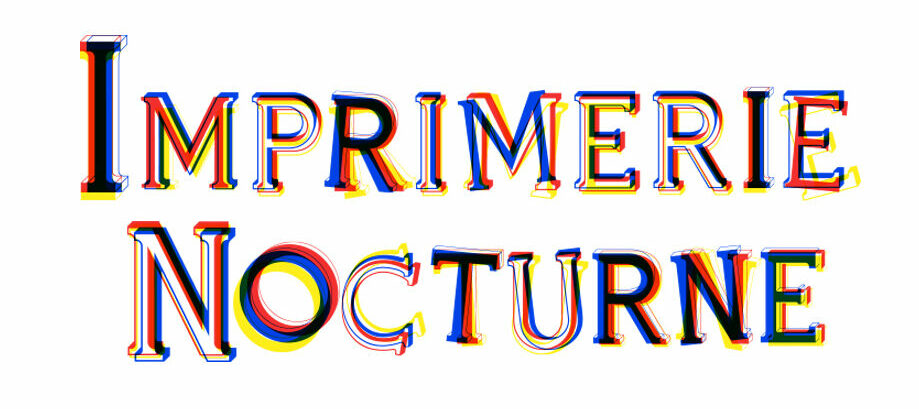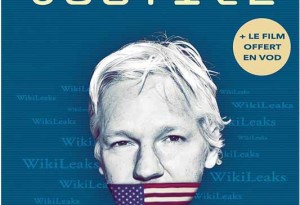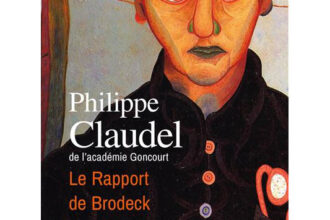Robert Merle, La mort est mon métier : un roman historique consacré à un technicien de la Shoah.
 Ce récit se base sur les mémoires rédigés par Rudolf Hoess lui-même et sur les entretiens et examens psychologiques que celui-ci passa entre mars 1946 (date à laquelle il fut capturé par les troupes alliées) et avril 1947 (date à laquelle celui qui fut le commandant du camp d’Auschwitz-Birkenau et contribua par son zèle effroyable à la mise en place accélérée de « la solution finale », fut pendu, sur décision de justice des autorités polonaises auxquelles il avait été remis). S’inspirant de ce personnage historique au destin méphistophélique, Robert Merle (1908-2004) écrit la biographie romancée de Rudolf Lang, l’alter ego de Rudolf Hoess. NB : c’est ce même commandant qui est le personnage central du film La zone d’intérêt de Jonathan Glazer.
Ce récit se base sur les mémoires rédigés par Rudolf Hoess lui-même et sur les entretiens et examens psychologiques que celui-ci passa entre mars 1946 (date à laquelle il fut capturé par les troupes alliées) et avril 1947 (date à laquelle celui qui fut le commandant du camp d’Auschwitz-Birkenau et contribua par son zèle effroyable à la mise en place accélérée de « la solution finale », fut pendu, sur décision de justice des autorités polonaises auxquelles il avait été remis). S’inspirant de ce personnage historique au destin méphistophélique, Robert Merle (1908-2004) écrit la biographie romancée de Rudolf Lang, l’alter ego de Rudolf Hoess. NB : c’est ce même commandant qui est le personnage central du film La zone d’intérêt de Jonathan Glazer.
« Vous devez savoir, enchaîna-t-il [Heinrich Himmler] aussitôt, qu’il existe déjà en Pologne trois camps d’extermination : Belzec, Wolzec et Treblinka. Ces camps ne donnent pas satisfaction. Premier point : ils sont petits et leur emplacement ne permet pas de les étendre. Deuxième point : ils sont mal desservis. Troisième point : les méthodes employées sont vraisemblablement défectueuses. D’après le rapport du Lagerkommandant de Treblinka, il n’a pu, en six mois, liquider plus de 80 000 unités. » (p. 274)
Cet ouvrage apporte une pierre qualitative à l’édifice délicat que constitue toute volonté d’appréhender comment il aura été possible que des humains en arrivent à d’aussi inimaginables massacres de masse perpétrés à échelle industrielle. Car si la Shoah a été possible, c’est parce que des humains y ont mis toute leur énergie, toute leur abnégation, toute leur macabre inventivité, déployant des trésors d’insensibilité pour résister psychiquement aux horreurs qu’ils commettaient, exécutaient ou ordonnaient et avaient au quotidien sous les yeux*. Et Rudolf Lang/Hoess a été, parmi des légions d’autres, l’un de ses plus implacables artisans.
Rudolf Lang/Hoess sera marqué par une enfance très austère, auprès d’un père glacial, intégriste religieux, d’une sévérité d’airain, qui aurait voulu que son fils se vouât à Dieu. Il s’engagera ensuite dans l’armée, très jeune, avant d’avoir l’âge requis, intégrant un corps de dragons expédié en Turquie où il se comportera en héros – et assistera à des massacres de villageois arabes persécutés par l’armée turque. Démobilisé, rejeté par les siens, il connaîtra ensuite la misère, la déprime de la défaite et l’humiliation du traité de Versailles, le travail en usine puis le travail à la ferme, tout en rejoignant dès 1933 les rangs du parti national-socialiste enchanté de recruter un élément de son envergure, à la fois discipliné, expérimenté, médaillé de la Première Guerre mondiale, dur au mal et revanchard.
Ses qualités vont lui permettre une ascension fulgurante au sein de la communauté nazie et il va assez rapidement intégré la Schutzstaffel (SS).
« J’apportais immédiatement une amélioration notable au système de Treblinka. Je fis inscrire sur les deux bâtiments : “Salle de désinfection”, et je fis installer, à l’intérieur, des pommes de douche et des tuyauteries en trompe-l’œil pour donner l’impression aux détenus qu’on les amenait là pour les laver. Toujours dans le même esprit, je donnais à l’Untersturmführer de service les instructions suivantes : il devait annoncer aux détenus qu’après la douche, du café chaud leur serait servi. » (p. 303)
 Par le biais de ce Rudolf Lang/Hoess, Robert Merle retisse un ensemble de circonstances qui, mises bout à bout, expliquent comment l’innommable a pu advenir. Parce que l’Allemagne nazie profitait, en matière de camps de concentration, d’un savoir-faire qui remontait à plusieurs décennies (passant par l’Afrique australe sous l’impulsion britannique, par Cuba où les Espagnols sévirent, par les Philippines où les Américains eux aussi établirent de tels camps, ou l’actuelle Syrie au moment de l’exode des Arméniens au début du XXᵉ siècle) comme le détaille la journaliste américaine Andrea Pitzer dans Une longue nuit – Une histoire globale des camps de concentration (remarquable ouvrage dont la traduction en français, très attendue, va paraître en juin 2024 aux éditions Les Perséides, voir ci-contre). Parce que l’Allemagne nazie s’était puissamment industrialisée (et disposait de chemins de fer, de fil de fer barbelé, d’usines qui avaient besoin de beaucoup de main-d’œuvre, d’une production d’insecticides chimiques standardisée, etc.). Parce que des fanatiques incroyablement antisémites placés au pouvoir ont eu dans leur élan exterminateur les coudées franches – ou du moins n’ont pas rencontré de résistances suffisamment solides pour empêcher ces sombres projets de se concrétiser. Parce que des hommes, d’une forme de crétinerie confondante mais néanmoins profondément convaincus de leur prétendue supériorité raciale, se sont pliés en quatre pour que se réalise l’épuration ethnique théorisée par les fondateurs d’un IIIᵉ Reich censé durer mille ans et qui s’effondra au bout d’une douzaine d’années tant ses bases étaient mortifères et inconséquentes. Parce que des techniciens, des organisateurs, des statisticiens, des hommes « consciencieux » comme pouvait l’être Rudolf Lang/Hoess, ont mis leurs compétences au service d’une entreprise (portée par l’État hitlérien et la SS d’H. Himmler en particulier) de déshumanisation d’autrui.
Par le biais de ce Rudolf Lang/Hoess, Robert Merle retisse un ensemble de circonstances qui, mises bout à bout, expliquent comment l’innommable a pu advenir. Parce que l’Allemagne nazie profitait, en matière de camps de concentration, d’un savoir-faire qui remontait à plusieurs décennies (passant par l’Afrique australe sous l’impulsion britannique, par Cuba où les Espagnols sévirent, par les Philippines où les Américains eux aussi établirent de tels camps, ou l’actuelle Syrie au moment de l’exode des Arméniens au début du XXᵉ siècle) comme le détaille la journaliste américaine Andrea Pitzer dans Une longue nuit – Une histoire globale des camps de concentration (remarquable ouvrage dont la traduction en français, très attendue, va paraître en juin 2024 aux éditions Les Perséides, voir ci-contre). Parce que l’Allemagne nazie s’était puissamment industrialisée (et disposait de chemins de fer, de fil de fer barbelé, d’usines qui avaient besoin de beaucoup de main-d’œuvre, d’une production d’insecticides chimiques standardisée, etc.). Parce que des fanatiques incroyablement antisémites placés au pouvoir ont eu dans leur élan exterminateur les coudées franches – ou du moins n’ont pas rencontré de résistances suffisamment solides pour empêcher ces sombres projets de se concrétiser. Parce que des hommes, d’une forme de crétinerie confondante mais néanmoins profondément convaincus de leur prétendue supériorité raciale, se sont pliés en quatre pour que se réalise l’épuration ethnique théorisée par les fondateurs d’un IIIᵉ Reich censé durer mille ans et qui s’effondra au bout d’une douzaine d’années tant ses bases étaient mortifères et inconséquentes. Parce que des techniciens, des organisateurs, des statisticiens, des hommes « consciencieux » comme pouvait l’être Rudolf Lang/Hoess, ont mis leurs compétences au service d’une entreprise (portée par l’État hitlérien et la SS d’H. Himmler en particulier) de déshumanisation d’autrui.
« Les convois de juifs devaient être considérés partout comme prioritaires, et passer même avant les transports d’armes et de troupes pour le Front russe.
Il n’y avait plus qu’à s’incliner. Ce n’était pas, cependant, sans dégoût que je voyais les camps que j’avais, dans les débuts, organisés de façon exemplaire, devenir, de semaine en semaine, un indescriptible chaos. Les détenus mouraient comme des mouches, les épidémies tuaient presque autant de monde que les chambres à gaz, et les corps s’entassaient si vite devant les baraques que les équipes spéciales qui les amenaient aux Crémas étaient débordées. » (p. 373-374)
Comprenant quelques pages abominables qui semblent décrire ce à quoi les Enfers pourraient ressembler, La mort est mon métier résonne ainsi comme un formidable avertissement adressé aux générations, présentes ou futures, afin qu’elles demeurent vigilantes face aux risques qu’encourent nos sociétés dites civilisées dès lors qu’elles emploient leur puissance colossale à mauvais escient, sans une once de déontologie, sans considération pour d’autres parties de l’humanité traitées comme négligeables – et donc bonnes à être sacrifiées sur un quelconque autel.
* Robert Merle expose toutefois le cas d’un SS-Ostuf qui, supposé avoir une âme d’artiste et ne supportant plus l’insupportable, mettra fin à ses jours : « Je me tue, parce que je ne peux plus supporter cette abominable odeur de chair brûlée », avoue-t-il dans une ultime pathétique confession (p. 364).
[box]
Robert Merle, La mort est mon métier, 1952, coll. « Folio », 1978, 418 p.
[/box]