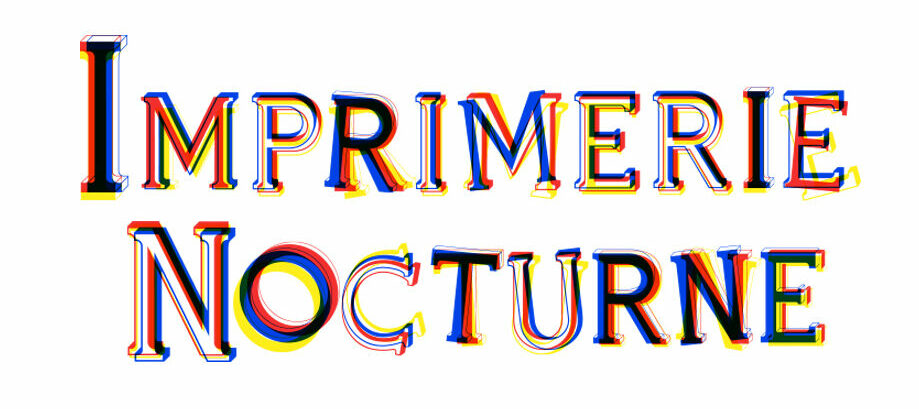Le film de François Truffaut Fahrenheit 451 (1966) est l’adaptation cinématographique du roman de science-fiction dystopique publié treize ans avant par l’Américain Ray Bradbury. Écrire sur ce film aujourd’hui permet de mettre en parallèle le monde désenchanté, superficiel et la mise en spectacle de notre actualité globalisée.
L’auteur Ray Bradbury déclare en 1980 qu’il ne cherche pas a faire déprimer ses lecteurs mais qu’il cherche à utiliser ses livres « pour combattre certain futurs » plutôt qu’à prédire des futurs. Dans le film, le rapport à l’image amplifie la société parfaite dans laquelle les protagonistes évoluent. Déjà, en 1966, s’affirme les techniques colorimétriques du technicolor (et des effets spéciaux) d’il y a plus de 50 ans. Les personnages en papier font partie d’une société totalitaire où il est strictement interdit de lire, et donc d’avoir accès à d’autres consciences humaines. Fahrenheit 451 signifie la température à laquelle un livre s’enflamme et se consume.

Une société sous contrôle
 Dans ce film, c’est la télévision qui est le regard omniscient. Cette fenêtre sur le monde domestique les comportements de l’audimat. Ce big brother est en fait encore plus séduisant et réduit les protagonistes à un état végétatif. Ils disent oui à tout. Et n’ont plus de souvenirs du passé, un peu comme les zombies. Les mémoires des personnages sont ancrées dans un ultra-présent consumériste. La nostalgie n’existe pas. Tout le monde doit penser de la même façon. Cette norme de pensée ficelle une société de contrôle. Les personnage ressemblent parfois à des poupées en cire. Et le modernisme des années 60 crée une esthétique lisse et artificielle dans laquelle est mis en abyme le texte littéraire de Bradbury. L’esthétique visuelle dans le film de François Truffaut met en exergue des images qui gouvernent les idées et le monde de Fahrenheit 451. La scène finale est vraiment terrible (ou porteuse d’espoir ?) car on y voit une « société-livre » fonctionner, c’est-à-dire que des intellectuels marginaux apprennent par cœur des œuvres qu’ils détruisent après avoir dévoré un livre en particulier.
Dans ce film, c’est la télévision qui est le regard omniscient. Cette fenêtre sur le monde domestique les comportements de l’audimat. Ce big brother est en fait encore plus séduisant et réduit les protagonistes à un état végétatif. Ils disent oui à tout. Et n’ont plus de souvenirs du passé, un peu comme les zombies. Les mémoires des personnages sont ancrées dans un ultra-présent consumériste. La nostalgie n’existe pas. Tout le monde doit penser de la même façon. Cette norme de pensée ficelle une société de contrôle. Les personnage ressemblent parfois à des poupées en cire. Et le modernisme des années 60 crée une esthétique lisse et artificielle dans laquelle est mis en abyme le texte littéraire de Bradbury. L’esthétique visuelle dans le film de François Truffaut met en exergue des images qui gouvernent les idées et le monde de Fahrenheit 451. La scène finale est vraiment terrible (ou porteuse d’espoir ?) car on y voit une « société-livre » fonctionner, c’est-à-dire que des intellectuels marginaux apprennent par cœur des œuvres qu’ils détruisent après avoir dévoré un livre en particulier.
Beau et terrible en même temps
Les personnages principaux sont les livres. François Truffaut axe son travail autour du graphisme des livres qui brûlent, parce que selon ce réalisateur, c’est beaucoup plus compliqué que l’on pourrait le croire de filmer des autodafés et des gros plans de phrasés qui s’enflamment littéralement sous les yeux du spectateur. C’est beau et terrible en même temps. Les flammes hypnotisent l’espèce humaine. L’auteur interroge le bonheur et l’on peut fortement se demander s’il est encore accessible. La beauté des pages brûlées est consumée par la voie off du pompier Montag qui interroge cette fascination qu’a l’être humain pour le feu. Il peut être intéressant de mettre en parallèle cet état de contemplation des flammes avec un livre de Gaston Bachelard (en particulier dans La psychanalyse du feu). La texture de la page qui noircit, se rapetisse et s’allège comme du carbone peut mettre en mémoire les livres « Cover » entièrement recouverts à la mine graphite du plasticien français Jean-Christophe Norman (à partir des années 2010).