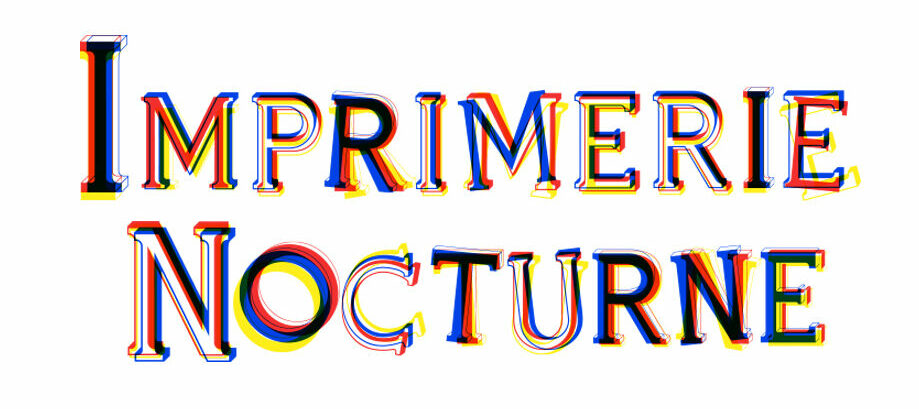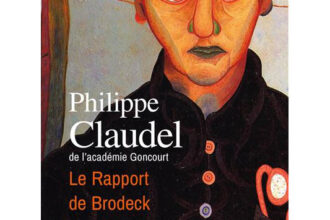« Faut être con, non ? » C’est la phrase qui clôture chacun des vingt chapitres de la nouvelle enquête d’Olivier Goujon parue en début d’année, Ces cons de journalistes. Après des mois de défiance face aux médias pendant les manifestations de Gilets Jaunes et les récents coups de gueule de journalistes pigistes, retour sur un essai nécessaire pour comprendre ce métier qui « meurt ».
« La précarisation du métier est bien la grande affaire du journalisme depuis le début du XXe siècle. Dès 1918, le naissant Syndicat national des journalistes (SNJ) en fait le cœur de son combat. Il s’agit de lutter contre la précarité héritée de la Première Guerre mondiale. Protection sociale, emploi, sécurité, liberté de la presse… , le syndicat attaque tous azimuts mais les résistances patronales et sociologiques sont fortes. Un journaliste de 1920 gagne moins qu’un employé et à peu près autant qu’un cheminot… Autant qu’un cheminot ? Voilà qui ferait tout de même rêver quelques pigistes de 2018 ! »
Ce métier de journaliste, Olivier Goujon le connait par cœur. Né en 1962 à Saint-Malo, il est diplômé de l’Institut pratique de journalisme en 1989, et vit entre Paris et Milan. Il écrit aussi bien qu’il photographie à travers 160 pays, et dresse au fil des années et des voyages les portraits de personnages traversant l’Histoire, comme les populations kurdes en lutte, féministes iraniennes, touaregs du Mali, le mouvement Femen (auquel il a consacré un livre en 2017, Femen, histoire d’une trahison), parmi plus de 500 reportages. Et ce métier, il l’aime et il y croit toujours, malgré la détérioration des conditions de travail, des salaires bradés (quand ce sont bien des salaires et pas des factures malgré la loi Cressard), des commandes parfois annulées à la dernière minute, une confusion grandissante entre journalisme, communication et publicité.
Il y a des reporters qui meurent comme Olivier Voisin, tué sur le terrain en Syrie en 2013, dont la passion pour son métier n’a protégé ni de la pauvreté ni d’un obus dans la tête. Il y a l’esprit corporatiste qui fausse la réalité où beaucoup de journalistes gagnent l’équivalent d’un RSA souvent dans la honte, et même après 40 ans d’une solide carrière, alors qu’une minorité, sous les projecteurs, « cinq cents fois plus ». Il y a le mépris du journaliste par une partie de la population et la police (le brassard presse a été instauré en 1982 pour limiter les tabassages en manifestation). Et encore et toujours il y a la casse progressive du prix du travail notamment via le modèle allemand (chapitre 5), dix richissimes patrons de presse voulant surtout vendre de la publicité au lectorat, sans oublier les magouilles politiques (le cas Gérard Collomb dans le chapitre 8), le modèle piège de la presse gratuite (chapitre 10). L’exemple terrifiant du Guatemala sacrifié par Edward Bernays (le père fondateur des relations publiques) pour des bananes en 1954 n’a toujours pas passé l’envie à certain·e·s journalistes et autres influenceurs de faire « acheter à coups de voyages, de foulards et de stylos » en pensant « qu’ils n’y perdraient pas leur âme » (chapitre 13). La course à l’information peut mener à des négligences souvent grave comme le traitement médiatique du suicide d’Oxana Shachko, amie d’Olivier Goujon et co-fondatrice de Femen (chapitre 16), ou du plagiat (chapitre 17). Le dernier chapitre revient sur la promotion d’un Conseil de déontologie pour réguler les pratiques et rétablir la confiance de l’opinion publique, qu’importe le propriétaire du média et de son bon vouloir.
L’auteur dresse un portrait rude et souvent peu flatteur de sa profession, non pas parce qu’il la méprise, mais parce qu’il veut pousser à la réflexion pour aboutir à des améliorations concrètes. La course à l’information peut même piéger les journalistes les plus aguerri·e·s, comme le prouve récemment la rumeur autour du supposé décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi (par Laura-Maï Gaveriaux). Les médias indépendants restent rares, comme Mediapart. L’entre-soi parisien blanc CSP+ est toujours de mise et pèse dans la relation de confiance avec le public (« Autocritique des médias, l’examen de confiance », publié le 19 janvier 2019 sur le site de Libération). Mais il existe des alternatives, comme le collectif Extra Muros (chapitre 19), appliquant l’adage « le journalisme [est] une affaire d’équipe et […] on y est plus intelligent à plusieurs ». Un autre collectif en non-mixité femmes fait de même, Les Journalopes (insulte fréquemment proférée notamment par un certain boxeur d’extrême droite sur canapé), pour se soutenir dans un milieu encore hostile aux femmes (le podcast « Injustices » de Louie Media aborde le sujet).
Le député Jacques Cressard a cru protéger de la précarité et de la corruption les journalistes avec sa loi du 4 juillet 1974. Si elle était correctement appliquée par tous les médias et que les revendications de la profession, notamment des pigistes (le collectif Ras la plume, le site Paye Ta Pige, monté à l’initiative de Nora Bouazzouni), étaient prises en compte, ça changerait significativement la donne pour la profession, ainsi que pour le public qui aurait une vision plus réaliste de la production de l’information, condition indispensable pour rétablir la confiance. Un essai à lire attentivement, qu’on soit journaliste, lecteur de médias ou fâché·e avec eux.
Olivier Goujon, Ces cons de journalistes, 187 pages, 18 euros, éditions Max Milo, publié le 24 janvier 2019. Il est sur Twitter.