M. Night Shyamalan vient conclure sa trilogie magistralement entamée avec l’extraordinaire Incassable (2000) et poursuivie avec Split (2016). Ce dernier, suite surprise du premier, marquait le retour aux affaires sérieuses du bon Shyamalan, après une série de terribles purges. L’annonce d’une suite, entrée finale de cette trilogie culte (surtout pour son premier opus) a évidemment ravi les foules, et c’est donc 3 ans plus tard que nous arrive Glass, conclusion épique tant attendue. C’est vraiment pas top, et on va bien spoiler pour en parler.

Samuel L. Jackson, James McAvoy et Bruce Willis reprennent leurs rôles dans ce pénible long-métrage.
Encensé par la critique et le public suite à l’incroyable succès de Sixième Sens (1999), puis Incassable, M. Night Shyamalan a vite dégringolé et connu pendant plus de dix ans la haine et le mépris des cinéphiles (à juste titre) pour ses productions suivantes. Limité par le budget sur Split, il resserre son intrigue et sa réalisation pour aller à l’essentiel de son récit, retrouvant la force de ses premiers succès : une caméra expressive (au lieu d’être seulement démonstrative) avec des cadrages dynamiques (qu’il avait auparavant pu essayer sur The Visit) qui sert une narration efficace et droit au but. Cette économie de moyen lui permettra un relatif retour en grâce, premier succès d’estime du réalisateur depuis une éternité. Il sera d’autant plus célébré que la fin de Split fait le lien avec sa dernière réussite en date, Incassable, dont il avait déjà annoncé au début des années 2000 la volonté de poursuivre l’histoire dans une trilogie. Ainsi, un réalisateur autant universellement adoré qu’il avait été ensuite haï faisait non seulement son retour à du cinéma correct, mais raccrochait en plus les wagons avec un film depuis devenu culte, tout en annonçant plancher sur la suite.
Résumé rapide du film : David Dunn (Willis) se fait à présent appeler le « Superviseur » par la presse, car il joue au vigilante, aidé par son fils. Ils finissent par retrouver Kevin Wendell Crumb, dit « la Horde » (McAvoy) qui avait kidnappé des pom-pom girls. Rapide confrontation, les autorités débarquent et arrêtent Dunn et Crumb, avant de les envoyer dans l’asile où Elijah Price (Jackson) est emprisonné depuis la fin d’Incassable. Ils sont tous trois placés sous la garde du Dr Staple (Paulson), chargée de déconstruire leur « délire mégalomane de super-héros ». S’ensuivent d’insupportables discussions que nous détaillerons plus bas, puis Price commence à mettre le boxon dans l’asile, chose aisée parce qu’il est apparemment devenu Lex Luthor entretemps (alors qu’il était auparavant… juste un type plutôt intelligent qui faisait péter des trucs) et peut sans problème contourner des serrures high-tech, éviter les caméras et se promener comme il veut dans l’établissement. En fauteuil roulant. Ensuite, chouette scène muette sur sa jeunesse (l’une des mieux réalisées du film, car c’est en fait une scène coupée d’Incassable). Il aide la Horde à s’échapper, Dunn les poursuit, puis bagarre sur le parterre de l’asile parce qu’il n’y a pas le budget pour faire plus. La Horde apprend que son père est mort dans le train qui a déraillé au début d’Incassable, donc à cause de Price, et brise une quinzaine d’os à ce dernier, avant d’aller se défouler sur Dunn, qu’il va envoyer dans une citerne. Bagarre, Dunn est bien affaibli parce qu’il a touché de l’eau (qui dans ce film est devenue sa kryptonite, alors qu’avant c’était juste… de l’eau). Casey Cooke (Taylor-Joy) qui entretemps s’était liée d’amitié avec la Horde réussit à calmer ce dernier avant qu’il ne soit abattu par un sniper avec un trèfle tatoué sur le poignet. Price est laissé pour mort, Dunn est noyé par un bonhomme avec ce même tatouage, et le Dr Staple (qui elle aussi a un tatouage) révèle que tout ça, c’est rien qu’un complot, et qu’elle fait partie d’une organisation déca-millénaire qui fait croire aux super-héros qu’ils n’en sont pas vraiment, parce que sinon ça fout le bazar. Le film se conclut sur Price qui en fait avait tout calculé parce qu’il est très fort pour leaker des vidéos de la bagarre finale et du complot, car « si les gens réalisent qu’ils peuvent être des superhéros, ils en deviendront et ce sera chouette ».
Sans exiger les sommets précédemment atteints en début de carrière, nous attendions du cinéaste qu’il prolonge (faute de conclure) son propos, et nous amène un nouvel angle sur des questions qui ont traversé son cinéma, de Praying With Anger, son premier film, à After Earth, film de commande aux accents scientologues qu’il parvenait pourtant à tordre pour y ramener des éléments personnels. Cent fois hélas, Glass n’apporte rien de nouveau et nous ressert les mêmes questionnements déjà évoqués par le passé, et résolus à la fin de chaque film. D’un côté, nous avons Ellie Staple (Paulson), qui rationalise constamment les faits de gloire de Dunn et Crumb (« superforce = adrénaline + coup de chance », « instinct quasi divinatoire = déduction plus ou moins consciente », etc.) dans de longs tunnels de dialogues qui rappellent les grandes heures de La Menace Fantôme et de ses midichloriens, soit expliquer et sur-rationaliser un élément narratif qui jusque-là était intangible et c’était très bien comme ça. De l’autre, Elijah Price (Jackson) qui contre-argumente le tout, en affirmant que « tout peut être chassé du revers de la main par une explication rationnelle. Pourtant, cela s’est bel et bien produit ».
S’il ne s’agissait que d’une redite, on pourrait encore supporter, pour peu que l’on ne nous assène pas ces thèses sur la nature réelle de nos héros avec une telle littéralité. Le regard caméra, figure de style récurrente chez le réalisateur, est ici employé à outrance pour appuyer les interminables tirades que nous servent les personnages, en soulignant bien souvent que « comme dans un comic book, le personnage traversera un moment de perte de foi ». « Finalement, ce n’est pas une édition spéciale cross-over, c’est une origin-story », etc. Répétant les mêmes erreurs que dans Signs, Shyamalan souligne ces coïncidences, et ne les rend que plus absurdes, puisque ce que l’on nous présente comme « des signes du destin » nous apparaît surtout comme des facilités d’écriture, et donc rend le récit d’autant plus balourd.
Question interprétation, ce n’est pas bien glorieux non plus. Non content d’avoir grignoté une partie non négligeable du budget pour son seul cachet d’acteur, Bruce Willis continue sa lente, mais inexorable chute vers les enfers du direct-to-video, aux côtés d’autres gloires passées du cinéma d’action. Inexpressif comme on l’a rarement vu, visiblement encore moins investi que pour son caméo à la fin de Split, il demeure monocorde, le visage crispé, sans jamais au moins essayer de jouer. Si Jackson y met plus du sien, c’est malheureusement lui qui a les répliques les moins bien écrites du film. MacAvoy est systématiquement légèrement à côté, alors que sa performance précédente était plutôt honnête. Le reste des seconds rôles se débattent comme ils peuvent pour paraître crédibles malgré des dialogues très très lourds (dont la moitié se voudrait pseudo-métadiscursive), le tout sans l’aide de Shyamalan pour les diriger, apparemment monopolisé pour gérer l’apathie constante de Willis.
La mise en scène, enfin, est pire que pauvre. Ici, il est en pilotage automatique, aussi amorphe que sur Phénomènes. La caméra filme platement l’action, et les nombreux regards caméra ou les quelques jeux de symbolique des couleurs n’élèvent nullement le niveau. Jamais l’émotion ne décolle, jamais ne se sent-on impliqué dans le film.
Alors, pourquoi en parler si longuement ? Il aurait certes suffi d’établir une liste des défauts, puis d’une recommandation d’usage pour tel ou tel film, au lieu de continuer à tirer sur l’ambulance. Seulement, Shyamalan est un auteur qui nous tient à cœur. Par des biais déguisés (le drame intime dans Incassable et le survival dans Split), et bien qu’abordant indirectement la question des superhéros, les deux premiers films traitaient en réalité de foi et de transcendance. Les deux personnages centraux de chaque film, David Dunn et Kevin W. Crumb, étaient chacun à leur façon confrontés à la réalité d’une morne vie, et finissaient par se dépasser eux-mêmes pour devenir plus qu’humains à mesure que les films avançaient et glissaient vers un autre genre cinématographique. Le cœur de ces œuvres n’était donc pas la gestion même des super-pouvoirs ni leurs implications dans un quotidien gris ; mais bien la question profonde que leur surgissement posait aux personnages : « Et si finalement, j’avais plus de valeur que je ne le pense ? » Cette interrogation, très ancrée dans le réel (et dans notre quotidien de spectateur à tous), venait chambouler la mélancolie des protagonistes et servait de fondation solide au récit.
L’arrivée d’Incassable en 2000, avant le succès de la première vague d’adaptation de comics (en tête de peloton, les Spiderman de Raimi), témoignait d’une incroyable compréhension des codes du comics, et de ce que ceux-ci signifiaient profondément. Les superhéros et leurs affrontements dantesques contre les forces du mal sont les héritiers des grands héros et des mythes fondateurs qu’ils traversent. En reconnaissant cette dimension profonde de ce qui était jusqu’alors (et même parfois aujourd’hui) perçu comme de la sous-culture pour ados décérébrés, Shyamalan faisait un bond de vingt ans en avant et proposait un discours extrêmement moderne sur son sujet. La justesse avec laquelle il abordait ces thèmes, ainsi que sa gestion du ton et du genre alors que le film se déroulait, évoluant doucement vers un tout plus épique, n’étaient rien de moins qu’un tour de force.
Entièrement investi dans son film, il créait de purs moments de cinéma en construisant des plans-séquences virtuoses qui venaient sublimer des scènes brillamment écrites, délivrées par un casting magnifiquement bien dirigé (dont Willis, qui y livrait une des meilleures performances de sa carrière). S’il ne fallait en citer qu’une, la scène d’affrontement entre Dunn et l’homme en orange. Il ne s’agit que d’une baston quelconque, mais qui fait l’effet d’un combat proprement épique, car elle est en réalité le signe d’un accomplissement absolu du personnage qui choisit d’embrasser sa nature et d’utiliser ses pouvoirs pour faire le bien.
De même que ses deux chefs-d’œuvre ne font hélas pas de Shyamalan un grand réalisateur, ses égarements successifs ne font pas d’Incassable ou de Sixième Sens des mauvais films. Si Glass, première suite sur laquelle il a dû travailler, est indéniablement un échec retentissant, Shyamalan n’en demeure pas moins un auteur à suivre. Son œuvre est cohérente, avec une ou plusieurs thématiques qui ressortent au long de sa filmographie, la foi devant les autres. On ne peut donc qu’espérer que les prochains soient, peut-être, des films un peu plus personnels, un peu moins forcés ; et en attendant, revoir Incassable.
Glass (2019), film de M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson. (129 min)
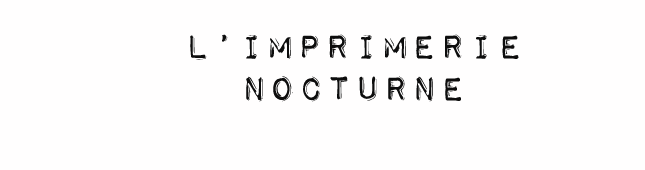




















![[Mythos] Vîrus : les 66. virgule](http://imprimerienocturne.com/wp-content/plugins/advanced-recent-posts-widget/timthumb/thumb.php?src=http://imprimerienocturne.com/wp-content/uploads/2024/04/vîrus-une.jpg&h=100&w=100&z=0)
![[Mythos] Bonnie Banane + Eloi + Mezerg](http://imprimerienocturne.com/wp-content/plugins/advanced-recent-posts-widget/timthumb/thumb.php?src=http://imprimerienocturne.com/wp-content/uploads/2024/04/BonnieBanane-3.jpg&h=100&w=100&z=0)


