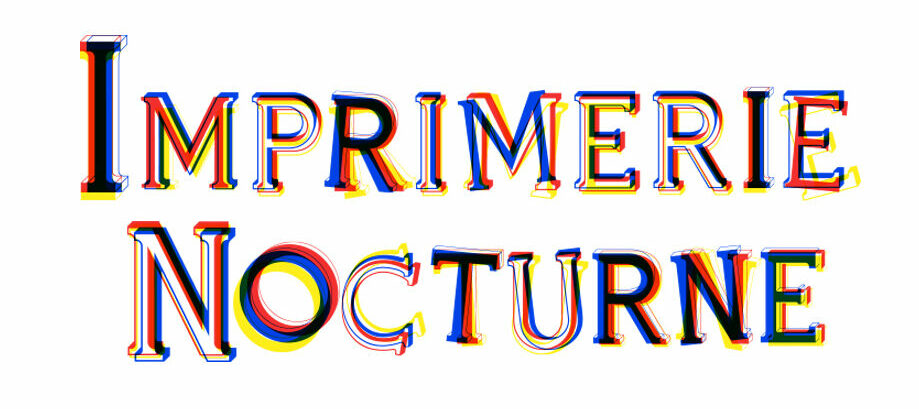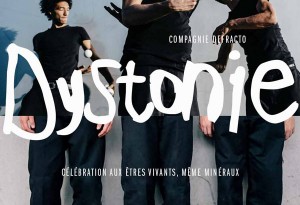Alice Zeniter a signé l’an dernier un roman vif et précis, dont l’audace lui a valu de remporter le prix Goncourt des lycéens. Dans L’art de perdre, qui tire son inspiration de sa propre expérience, l’auteure traite du rapport à la migration et au déracinement, au sein d’une famille, sur trois générations. D’origine algérienne, Zeniter raconte la trajectoire de son grand-père, Ali, qui fit partie de ceux que l’Histoire a retenus sous le nom de « harkis » ; ici comme souvent, le langage fixe en un terme ce qui désigne en réalité une pluralité de parcours singuliers et complexes.
Les relations entre les personnages évoquent un emboîtement de poupées gigognes: les membres de cette famille se renvoient d’une génération à l’autre des barrières de silence, s’objectant mutuellement des « Tu ne peux pas comprendre ce que j’ai vécu », révélateurs de douleurs inexprimables, bien que perçues par chacun. Cependant, le récit littéraire permet au lecteur d’avoir un regard surplombant sur ces existences singulières et cloisonnées, et de percevoir l’ensemble des vécus qui s’entrecroisent. C’est qu’il doit y avoir, à condition d’avoir la bonne qualité d’écoute, une possibilité de s’écouter, de s’entendre.
D’une manière très vivante et ancrée dans le corps et la sensibilité de ses personnages, Alice Zeniter s’écarte de l’analyse historique pour proposer une autre porte d’entrée pour comprendre ce qui se joue : la dramaturgie, la description des causes et des raisons, la subtilité des choix et le rôle du hasard dans les chemins qui forment une vie.
Rencontre avec l’écrivaine, à la terrasse d’un café rennais.

L’Art de perdre est un livre qui fait très certainement écho à un grand nombre de gens, que la trajectoire personnelle de tes lecteurs implique ou non une histoire liée à l’exil ou au colonialisme. Lors des rencontres avec tes lecteurs, on doit beaucoup t’investir, te faire part de choses intimes…
Il y a des gens qui arrivent et qui se mettent à pleurer. Ce qui est étrange c’est que le livre fait écho à des choses tellement différentes que je ne peux pas deviner pourquoi la personne arrive avec les larmes aux yeux, me fait part de choses crûment violentes : « J’ai perdu mes deux frères en Algérie pendant la guerre, c’est la première fois que je trouve le courage de lire un bouquin là-dessus et du coup je suis en train de revivre mon deuil », ou « Mes parents sont partis d’Algérie en 62, ils ont toujours dit qu’ils voulaient être enterrés là-bas et je n’ai pas réussi à faire accepter ça, j’ai trahi la dernière volonté de mes parents… » C’est à la fois une situation où tu ne peux pas refuser ça, tu es obligée d’accepter l’émotion que les gens t’apportent ; et en même temps, je ne veux pas me mettre dans une position de gourou, je ne veux pas proférer des paroles de consolation qui auraient un poids, sous prétexte que je serais la figure d’autorité en tant que figure d’écrivain… Je ne veux pas prendre ce rôle-là.
En même temps c’est le signe que ton écriture a un pouvoir de changement, ou au moins le pouvoir d’amener les lecteurs à s’intéresser à certains aspects de leur propre histoire, à créer de nouvelles connexions… le partage littéraire, par l’expérience de lecture qui est une pratique intime, peut sans doute amener à questionner les gens individuellement, mais de ce fait créer une réflexion globale.
Je pense que c’est clairement un pouvoir de littérature que de venir créer de la pensée et de l’affectif autour de trajectoires auxquelles les gens ne penseraient pas forcément, ou ne se seraient pas forcément attachés. C’est une des choses dont je peux créditer les œuvres d’art, en tant que lectrice, ou même de spectatrice quand je pense au cinéma : de m’avoir fait bouger par rapport à certaines choses et d’avoir tout à coup l’impression que des problèmes extrêmement lointains sont devenus mes problèmes personnels, qu’ils m’affectent de manière urgente, brûlante, énorme, alors que dans ma vie quotidienne, rien de ça ne m’atteindrait. Je pense notamment au cinéma sud-coréen qui m’a fait ça pendant des années, la question de la répression des révoltes étudiantes dans les années 90, j’avais l’impression que ça m’atteignait dans ma chair, et en fait c’est juste le pouvoir du cinéma. Donc oui, le livre peut faire ça aussi ; une lycéenne m’a demandé si mon livre pouvait faire changer la situation des femmes en Algérie. Je lui ai dit que ce n’était pas le but du livre, tout d’abord parce que pour faire changer une situation dans un pays il faudrait écrire dans et pour ce pays, et que là, je sais que le livre est lu beaucoup plus massivement en France qu’en Algérie…
Ah oui ? Quelle réception ton livre a-t-il eu en Algérie ?
Il est lu en Algérie, mais il n’a pas été republié à des prix de livres algériens, donc il coûte très cher et ne peut toucher qu’une certaine élite… Par contre, une des choses qui me feraient plaisir, c’est que les gens qui vivent ici pensent aussi aux figures de femmes algériennes (notamment au personnage de Rachida dans la troisième partie) et à ces nanas qui font de leur vie un combat pour que la liberté qu’elles ont eue dans les années 70 ne diminue pas. Que quand on pense à l’Algérie on ne pense pas qu’au pétrole, à Boutef et à la guerre d’Algérie, mais aux trajectoires présentes des gens. Je me disais que si Rachida existe dans la pensée de quelques milliers de lecteurs français, alors ça c’est réussi, c’est un combat en soi victorieux… mais de là à parler de révolution…
Le récit de l’histoire de Naïma est-il réaliste, ou comporte-t-il une grande part d’invention ? Qu’est-ce qui en elle est proche de ton vécu ? Son voyage en Algérie ressemble-t-il au tien ?
Il y a des deux. Moi j’y suis allée deux fois, la première fois sans aller jusqu’au village de ma famille. J’avais aussi en tête le voyage de ma petite sœur, qui elle a fait un mémoire de master sur Kateb Yacine, qui en commençant à présenter son travail dans des colloques s’est retrouvée à parler avec des vieux intellectuels algériens, et est allée en Algérie la première fois pour faire une communication au milieu de gens qui étaient les passeurs qu’elle-même s’était choisis. Sans aucune obsession d’une mémoire personnelle et familiale, vers une Algérie qui elle l’intéressait : celle de la littérature, du théâtre et de la politique. Le lien Naïma-Lalla vient beaucoup de ce qu’a fait ma sœur : elle s’est construit un lien avec une Algérie qui lui ressemble. Moi j’ai eu aussi très fort cette question-là : quand tu viens dans un pays à la recherche d’un souvenir que tu ne peux pas avoir, alors qu’est-ce que tu fous là ? Et c’est vrai qu’à partir du moment où tu crées tes propres connexions, où tu viens avec un projet, tout devient différent… Moi, la première fois que j’y suis allée, c’était dans le cadre d’un documentaire qu’un ami, Jean Boiron-Lajous, tournait sur ce voyage, qui s’appelle La Mémoire et la mer, et qui pose une question : Qu’est-ce que c’est d’avoir des liens avec un pays qu’on ne connaît pas, et qu’est-ce qu’on fait de ça ?
Et puis pendant que j’étais là-bas on a rencontré des gens avec qui Jean avait des contacts, des réalisateurs, qui sont devenus des copains… Ensuite j’y suis retournée avec une copine comédienne dans le cadre d’un festival de théâtre, pour présenter un monologue. C’est dans ce festival-là que j’ai rencontré toute la bande qui a donné naissance à Rachida et Mehdi, une bande d’artistes déjantés, et je me sentais bien avec eux. Et puis à un moment je suis partie en Kabylie, parce qu’il y a eu une discussion, un peu comme dans le roman, où quelqu’un a dit « Mais bien sûr qu’elle peut aller là-haut ! Moi j’y vais tout le temps même s’il y a des barbus, je t’emmène demain ! » et un tope là qui s’est soldé par un départ en haut de la montagne le lendemain. Arrivée en haut je me suis dit « je l’ai fait », mais maintenant que je l’avais fait, je voulais retourner avec mes amis. La biologie, ici, n’était pas le plus important. L’important pour moi a été, au contact de ces personnes, d’avoir l’image d’un pays au présent.

Ce n’est pas une chose anodine que le livre ait reçu le Goncourt des lycéens. C’est un prix particulier, un prix de lecteurs ; d’après les retours que tu as pu avoir, qu’est-ce qui dans ton roman a interpellé les lycéens, la jeune génération ?
Parmi ces lecteurs, il y a clairement un certain nombre de lycéens qui sont eux-mêmes issus de l’immigration et qui cherchent à savoir ce qu’ils font de ça : qu’est-ce que ça veut dire « avoir une double culture », quelle place laisser à ça ? Est-ce qu’on revendique, est-ce qu’on cache, est-ce qu’on est stigmatisé ? Ce sont des choses dont on a beaucoup parlé. Après, l’idée d’une structure familiale pour des gens qui sont encore en train de vivre dedans, mais qui vont bientôt en sortir pour vivre leur vie de façon indépendante, c’est aussi très prégnant. La question de la liberté de s’inventer soi-même et de quelle manière elle est en fait très limitée; on pose ça comme un idéal, mais sans réaliser tout ce qui la rogne de partout. Et puis je sais pas exactement ce qu’il s’est passé… Dans le jury, il y avait deux lycéens qui ont été mes plus fervents supporters : l’une l’était de manière très émotionnelle, elle avait même du mal à mettre des mots pour en parler, et elle m’a juste dit : « Je me suis mise à pleurer pendant les débats à l’idée que votre livre puisse sortir de la sélection, c’était insupportable pour moi » et elle s’est remise à pleurer en me disant ça – du coup on s’est fait des câlins, mais on n’a pas beaucoup parlé du livre ! Et l’autre, Lucas, qui m’a dit : « Moi je voulais absolument que ce soit celui-là parce qu’à la base, j’aime pas lire, mais celui-là c’est le premier livre que j’ai aimé lire ». Donc c’est un énorme compliment, mais moi je sais pas pourquoi ! Pourquoi ce livre-là, tout à coup, réveille un appétit de lecture chez un adolescent qui ne lit pas… quand je lui ai demandé il m’a dit : « Parce qu’il est super ! »
C’est vrai qu’une des choses qui fonctionnent vraiment dans ce livre, c’est qu’il est épique ! Le récit de cette migration est mené selon une dramaturgie particulièrement maîtrisée, et une véritable empathie se crée pour chacun des personnages. En tant que lecteur, on en vient à comprendre une situation globale, qui semble d’ordinaire ou trop complexe, ou trop lointaine. On arrive à faire cohabiter des contradictions, et à la fois à se sentir proche des personnages.
La multiplication des points de vue permet ça. Et par ailleurs, quand tu racontes l’histoire depuis un autre point de vue que celui des puissants, ça permet aussi qu’il y ait une identification qui soit beaucoup plus grande. C’est ça qui frustre aussi quand on lit des livres d’Histoire ; quand tout ce que tu lis c’est des négociations entre De Gaulle et le GPRA ou ce genre de choses, oui, tu as l’impression que ça ne te concerne pas, que l’Histoire se déroule sur une ligne parallèle à la vie des gens, que personne n’a de pouvoir dessus… c’est différent quand tu dis que l’Histoire, avant d’être écrite comme analyse des réseaux de pouvoir à la tête de l’État, est aussi une situation présente, que les gens ne comprennent pas forcément mais dans laquelle ils sont plongés et qui les atteint d’une manière ou d’une autre. Que nous sommes, tous, l’Histoire en train de se faire, et qu’il n’y a pas besoin d’avoir une compréhension des enjeux globaux pour faire partie de l’histoire. C’est même ça le drame, tu ne la connais pas au moment où elle est en train de se construire.
Et puis on entre toujours dans la vie par le corps, c’est ce que la littérature permet de faire : tout à l’heure en librairie, il y avait une classe de lycéens qui me demandait quelle était la différence entre histoire et littérature. Et je leur répondais que, même si on ne parle que des puissants, lorsque dans un livre d’histoire vous lisez : « À la table de négociations s’assirent untel, untel et untel », vous avez l’impression que tout le monde sait exactement de quoi il est question, que les pensées de chacun des participants sont centrées sur une seule chose : débattre de comment négocier l’indépendance et à quelles conditions. Alors qu’en fait, comme on est tous aussi notre corps, il y a peut-être un des hommes dans la salle qui est en train de penser que ses chaussures lui font mal aux pieds ; est-ce que ça se fait d’enlever ses chaussures sous une table de négociations ? Est ce qu’il va être repéré ? Est-ce qu’au moment de se lever il aura le temps de les remettre, etc., en fait les souvenirs qu’il aura de cette journée, même s’il ne les racontera pas comme ça parce qu’il sait que ce moment doit faire partie de l’Histoire, hé bien ce seront aussi en partie des souvenirs de chaussures ! Donc j’estime qu’il est important de replacer le corps dans ces situations rendues neutres par l’Histoire.
« Nous sommes tous l’Histoire en train de se faire »
Ce qu’Ali apprécie lorsqu’il va à l’association des anciens combattants, c’est qu’à cet endroit, il n’a pas besoin d’expliquer quels événements il prend en compte dans son vécu, il n’a pas à évoquer telle ou telle bataille qui l’a marqué pour que tous sachent qu’elle a eu lieu. Faire partie d’une même communauté, ce serait donc savoir qu’on partage un même socle de langage ?
C’est une question centrale, qui revient à différents moments, comme dans le passage du démantèlement des camps (camps de réfugiés algériens établis en France après l’indépendance en 62, ndlr): quand bien même le camp n’existe plus, il y a des gens qui vont s’installer à proximité et qui vont continuer à vivre ensemble alors qu’ils sont libres de ne plus le faire. En fait, ce sont des gens qui ont pu tomber d’accord entre eux sur une version de l’histoire. C’est un principe de base de la communauté, auquel on pense trop rarement mais qui est probablement un des plus importants : le fait de ne plus avoir à s’expliquer. On sait de quoi on parle, quand bien même on ne ferait que l’effleurer. Et dans ces conditions, il y a une facilité du vivre ensemble – pour reprendre un terme d’urbanisme à la mode. C’est la même chose quand Ali retrouve Mohand à Paris : ils ont beau ne pas avoir pris du tout les mêmes voies, on pourrait penser qu’ils sont totalement séparés par leurs trajectoires différentes pendant et après la guerre, mais eux savent ce qu’il s’est passé pour eux, et donc même s’ils ne peuvent pas se comprendre, ils peuvent au moins comprendre pourquoi ils ne peuvent pas se comprendre, et c’est suffisant pour qu’ils soient contents de s’être revus. C’est quelque chose qui va revenir pendant tout le livre.
Il y a là une piste de réflexion intéressante sur ce qu’il serait possible d’ouvrir comme espaces de conversation pour tenter, collectivement, de parvenir à « parler des mêmes choses »…
Ce qui est étrange en ce moment, c’est que dans le temps de la politique accéléré par les réseaux sociaux, il n’y a plus le temps d’une écoute, où l’on attend de savoir, ou l’on cherche à savoir ce que l’autre veut dire lorsqu’il emploie tel ou tel terme. On se dresse aussitôt vent debout contre le fait d’utiliser le terme en question, quand bien même la personne ne voulait pas dire ce qu’on l’accuse d’avoir dit. Et ça, ça crée pour moi une espèce de folie de la parole. C’est pour ça que la littérature pour moi est si importante à côté : je me dis que là, il y a un temps de l’écoute avant même l’écriture ou dans l’écriture – puisqu’on écoute ses personnages aussi – un temps qui fait du bien, comme arrachement à cette folie.
On pense aussi à ce moment où Hamid tombe vraiment amoureux de Clarisse, lorsqu’il comprend que pour elle, il a « droit à l’immensité, comme tout le monde ». Il y aurait là aussi quelque chose à ouvrir de ce côté-là, peut-être le cœur de la notion d’égalité pour laquelle il faudrait se battre.
Et qui est dévoyée par le propos politique, puisque le droit à l’immensité c’est autre chose que de dire « Tous les jeunes peuvent devenir millionnaires », qui là est une négation de la réalité des déterminismes, et qui du coup se transforme en accusation : « Si tu n’as pas réussi c’est de ta faute, puisque tout le monde pourrait l’être ! » Le droit à l’immensité dans le regard de Clarisse ce n’est pas ça, ce n’est pas pas une obligation à l’immensité, c’est quelque chose qui reconnaît la difficulté – mais qui fait écho à la discussion entre Ali et le professeur de Hamid, sur la pyramide sociale tronquée, dont le travailleur social représente le sommet à partir du moment où tu viens de la ZUP. C’est dire qu’on a le droit d’essayer de s’inventer hors de cette pyramide sociale tronquée, mais ce n’est pas parce qu’on a ce droit-là qu’il existe une réelle égalité des chances.