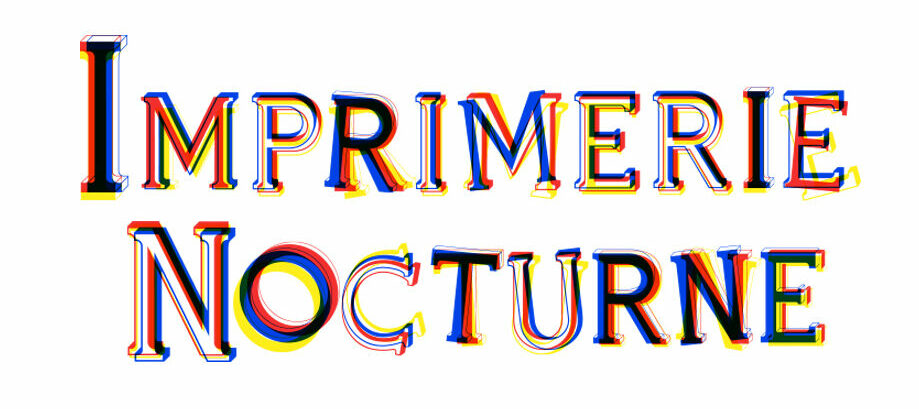La Douleur : un drame historique d’Emmanuel Finkiel, d’après l’œuvre largement autobiographique éponyme de Marguerite Duras (1914-1996) parue en 1985 aux éditions P.O.L.
Ce n’est pas facile, a fortiori quand elle est intense, inextinguible, viscérale, d’exprimer la douleur. Ici il s’agit de celle de Marguerite Antelme (Mélanie Thierry), écrivaine. On est courant 1944, à Paris, sous l’Occupation.
Son mari, Robert Antelme (Emmanuel Bourdieu), résistant au sein du réseau d’intellectuels de la rue Saint-Benoît, a été arrêté. Fiévreusement, Marguerite attend son retour, angoissée. On le serait à moins quand on sait le sort réservé aux prisonniers politiques qui tombent entre les mains de la police collaborationniste. Éplorée, Marguerite fait des pieds et des mains pour avoir de ses nouvelles, y compris auprès de l’inspecteur Ravier (Benoît Magimel), sensible à la dimension de romancière célèbre de son interlocutrice, mais qui croit dur comme fer que « l’Empire est solide« , que la victoire allemande se profile et qu’il pourra dès lors ouvrir une petite librairie d’art (NB : preuve s’il en est, certes a posteriori, qu’il n’y a pas que de grands visionnaires dans la police).
 Soutenue plus que fermement par Dionys Mascolo (Benjamin Biolay, très convaincant une fois encore), Marguerite tient plus ou moins le choc.
Soutenue plus que fermement par Dionys Mascolo (Benjamin Biolay, très convaincant une fois encore), Marguerite tient plus ou moins le choc.
S’appuyant sur le roman de Marguerite Duras, La Douleur est une occasion supplémentaire (à jamais utile) de raviver la mémoire de l’Holocauste, d’évoquer les horreurs qui furent perpétrées à Buchenwald, Bad Gandersheim ou Dachau (où Jacques Morland, alias François Mitterrand, joué ici par Grégoire Leprince-Ringuet, ira récupérer un Robert Antelme à l’agonie, atteint par le typhus, diminué par la captivité, les brimades et les marches forcées, en avril 1945), de rappeler l’incroyable courage dont durent faire preuve pour simplement survivre les rescapés des « camps de la mort », de mieux comprendre cette époque immensément violente, trouble et compliquée (révolue) et le défi que ce fut, dans une France libérée, en liesse, d’accueillir ceux qui revenaient de l’Enfer.
Qui plus est, quand, comme votre dévoué chroniqueur, on vit dans un quartier quadrillé par la rue Louis Turban, résistant mort en déportation (1901-1944), la rue Honoré d’Estienne d’Orves, résistant fusillé par les Allemands (1901-1941), la rue Yvonnick Laurent, résistant victime de la milice (1923-1944), la rue Jean Nobilet, résistant mort en déportation (1888-1944), la rue Émile Drouillas, militant ouvrier mort en déportation (1900-1942), le boulevard Oscar Leroux, ancien adjoint au maire de Rennes, victime le 1er juillet 1944 d’une tentative d’assassinat par le Cercle d’études national-socialiste (CENS), la rue Alfred Lavanant, combattant de la Libération (1921-1944), la rue Joseph Vaillant, résistant fusillé (1921-1942), le boulevard Gaëtan Hervé, victime de l’occupation allemande (1886-1944), la rue Jean Bras, résistant fusillé (1899-1942), la rue Jean Le Ny, résistant déporté (1891-1944), la rue Raymond Hermer, résistant fusillé (1903-1944), etc., on est peut-être plus que d’autres sensibilisé au devoir de mémoire. C’est là de toute façon la vertu de l’Histoire et des œuvres qui la traitent : rappeler pour mieux avertir, étudier pour mettre en garde, raconter pour édifier.
[box]La Douleur – Drame historique d’Emmanuel Finkiel (d’après l’œuvre de Marguerite Duras) – Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Grégoire Leprince-Ringuet… – Durée : 2h07 – Sortie le 24 janvier 2018.[/box]