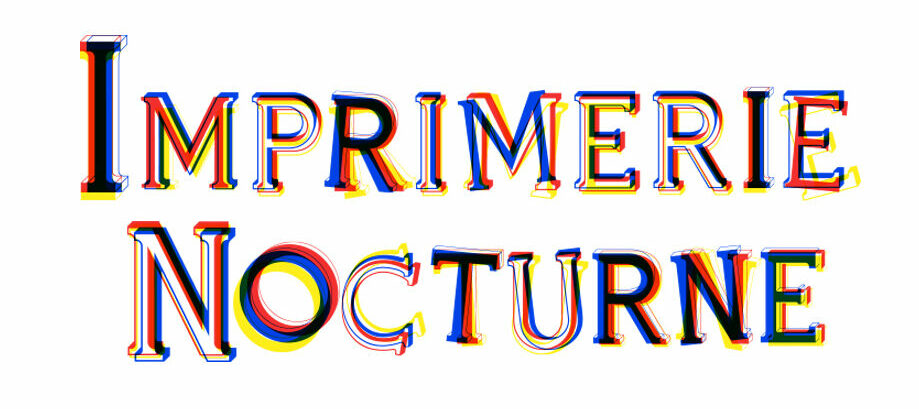Aller voir le dernier Woody (allons-y gaiement, appelons-le par son prénom, après toutes ces années, tonton Woody ne fait-il pas quasi partie de la famille) est un des rituels annuels du cinéphile moyen. Qu’aura-t-il encore à prouver, ce vieux briscard du cinoche amerloque ? Quelles surprises réserve-t-il ? Quelles trouvailles et facéties agrémenteront l’opus ? Quels arômes développera-t-il, plutôt prune ou plutôt banane ? Aha, non, ça s’est le beaujolais nouveau…
Café Society reprend donc le thème inusable des amours impossibles entre Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg), jeune New Yorkais débarquant à Hollywood pour y trouver du boulot, et une jolie secrétaire de la côte Ouest (Kristen Stewart) qui bosse justement pour l’oncle de Bobby. Les costumes des Années Folles, tout comme les éclairages sont soignés : soleil et costards crème pour les scènes à Los Angeles, ambiances froides et sombres pour les séquences urbaines de la Côte Est.
Comme une sorte de running gag, le frère mafioso de Bobby apporte à intervalles réguliers un peu de rythme – et une violence digne de Casino de Scorsese. La mère de Bobby apporte la petite touche relative aux mères juives, forcément intrusives, possessives et soucieuses de leur fragile progéniture (Woody épuisera-t-il un jour le ressort psychanalytique du rapport à la mère ?). Mme Dorfman, en tout cas, ferait mieux de s’occuper du grand frère de Bobby plutôt que de celui-ci dont les activités largement innocentes n’ont guère de risques de le conduire à la chaise électrique… Mais ce frère mafioso n’est-il pas tout bonnement irrécupérable ? Et sommes-nous ici, de toute façon, pour donner des leçons quant aux meilleures façons d’éduquer ses garçons ?
Bobby n’est pas mécontent d’avoir pour jolie guide l’espiègle Vonnie.
Toujours est-il, donc, que Café Society est un cru, diront les gourmets, un peu désincarné. On y goûte certes de jolis portraits de femmes (les femmes de la vie de Bobby, Veronica/Blake Lively et Vonnie/Kristen Stewart, sont toutes deux plus que ravissantes). Bien sûr, contrastées, un peu piquantes, les figures masculines, avec l’aussi vaniteux que tout-puissant oncle Phil (Steve Carell), le minable bien-pensant (le beau-frère de Bobby), le fascinant de dangerosité (le frère de Bobby), l’effacé (le père de Bobby), ou le plein de ressources bataillant plus ou moins vainement contre un destin sado-comique (Bobby lui-même), saupoudrent le tout de cette misanthropie légère chère à Woody.
Mais on quitte la salle sans ivresse, sans être conquis, sans avoir été mis à genoux. Le vieux Woody, qui a plus d’un tour dans son sac, voudrait-il par là-même nous apprendre à ne pas faire la fine bouche face à une œuvre d’art, à ne pas nous montrer ingrats face à une telle production qui rend hommage si élégamment aux belles heures de cet Hollywood d’avant-guerre que seuls parmi nous quelques centenaires connurent ? Ou bien Woody, vieillissant, n’aurait-il plus ce besoin de surprendre, de se surpasser ? Se serait-il endormi sur ses innombrables et mérités lauriers ? Aurait-il cédé aux sirènes de la facilité intrinsèquement liées à l’industrie (lourde) du cinéma d’Outre-Atlantique ? Jugez par vous-mêmes.
[box]
Café Society, comédie dramatique de Woody Allen – Avec Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Steve Carell… – Durée : 1h36 – Sortie le 11 mai 2016 – Film d’ouverture du Festival de Cannes.
[/box]