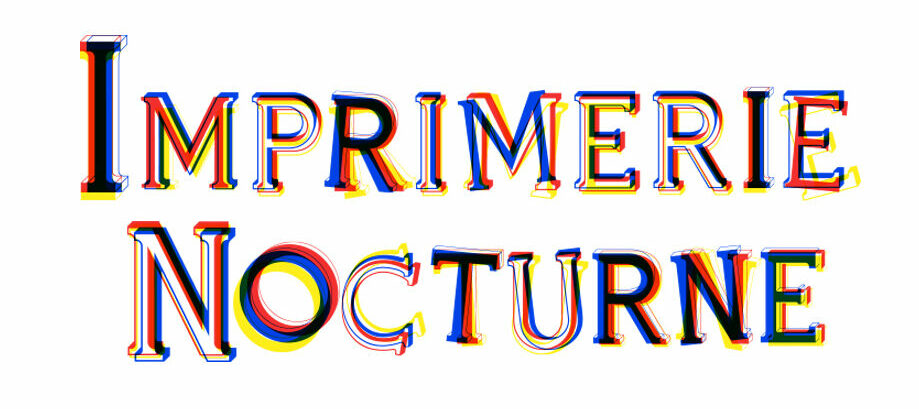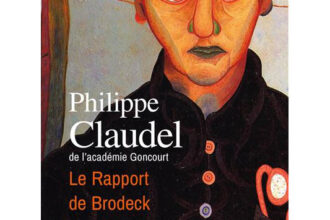L’homme effiloché est un récit à la croisée des genres, signé Felipe H. Cava et Sanyù. Le récit, le dessin et la narration se distinguent et se tricotent ensemble, dans une sorte de fresque expressionniste d’une richesse merveilleuse. Et troublante. Où l’on explore la folie et le destin des âmes troublées.
L’histoire est complexe au premier abord. Tout semble converger vers un dénouement lugubre, dont les causes s’entremêlent, sans que l’on s’y retrouve forcément au départ. Je m’explique.
Felipe Hernandez Cava, le scénariste, imagine ici les derniers jours de Guy de Maupassant, qui sombre alors dans la folie, une folie aux multiples origines, à la fois familiale (puisque le frère de celui-ci mourut de démence), littéraire, paranoïaque, intellectuelle, syphilitique… Et c’est durant ces épisodes démentiels que Maupassant écrit les versions du Horla… récits fantastiques où le personnage principal est pris de démence fulgurante, de la peur de « l’Être » invisible venant lui aspirer sa vie, le noyant dans des angoisses insurmontables.
Alors le scénariste invente un récit étourdissant où se mêlent fictions, biographie d’invention et délires poétiques.
Donc, bien entendu, il n’est pas aisé pour le lecteur, au départ, de s’y retrouver… de démêler les interactions entre le récit des derniers jours de l’auteur de Boule de suif et les inspirations du Horla… Mais lorsqu’on trouve notre endurance, que le rythme est calé, que le fil est saisi, on est arraché, tiré, cogné contre les parois de ce labyrinthe où sombre l’âme humaine lorsqu’elle essaye de comprendre « pourquoi la vie elle-même est-elle un torrent si terrible et qui va se perdre dans l’océan sans borne de la mort » (épilogue, tiré de Mémoires d’un fou de Gustave Flaubert).
Maupassant cause avec les morts. Retrouve Flaubert. Gérard de Nerval, pendu plusieurs décennies plus tôt, et qui lui revient, la corde au cou, comme le fantôme de son action ratée, puisque Maupassant vient de tenter de se suicider… voilà pourquoi on l’interne dans l’hôpital du docteur Blanche, un aliéniste célèbre du XIXe. Il retrouve son frère, mort quelques années plus tôt. Évoque Nietzsche, qui lui rend visite « nuitamment », et qui lui inspire des quatre pattes à écumer de la bouche tel le cheval que défendit le philosophe contre un cocher maltraitant… ça valse à tout va… on est jeté, littéralement, d’une page à l’autre, sans avoir le temps de reprendre un quelconque souffle, de retrouver ses esprits…
Et les questionnements surgissent en même temps que ses fulgurances. « L’Être lit par-dessus son épaule, son haleine lui frôle l’oreille. Il se lève et se précipite devant le miroir pour observer ses yeux affolés. Mais il ne voit pas son reflet, que le corps imperceptible de la chose a dévoré » (p. 46).
Je sens que deux hommes cohabitent en moi
 Parce que, comme le disait un des pères de l’Église, cité parmi ces pages : « Je sens que deux hommes cohabitent en moi » (p.53). Le bon et le mauvais génie. Et ces esprits viennent-ils, au bout d’un moment, à se séparer ? L’un prenant le pas sur l’autre ? Maupassant, en même temps que nous lecteurs, se prend à creuser les ténèbres… fait naitre le doute sur la condition humaine… le doute qui plonge irrémédiablement l’âme dans des tourments sans fin…
Parce que, comme le disait un des pères de l’Église, cité parmi ces pages : « Je sens que deux hommes cohabitent en moi » (p.53). Le bon et le mauvais génie. Et ces esprits viennent-ils, au bout d’un moment, à se séparer ? L’un prenant le pas sur l’autre ? Maupassant, en même temps que nous lecteurs, se prend à creuser les ténèbres… fait naitre le doute sur la condition humaine… le doute qui plonge irrémédiablement l’âme dans des tourments sans fin…
À la croisée des genres, ce livre, parce que récit, fiction, essai philosophique, voyage littéraire chez les poètes et romanciers du XIXe siècle.
Et le dessin, nous n’en avons pas encore parlé. Pourtant, une bande dessinée ne doit-elle pas être la combinaison parfaite du récit et de son illustration ? Pas toujours non. Je veux dire par là que le récit et l’illustration peuvent être indépendants, dans le sens où l’un n’illustre pas forcément l’autre, mais le complète. Autant la narration est pourvue d’une vraie poésie. Mais alors le dessin est… frénétiquement poétique… Sous le coup de patte de Sanyù, un dessinateur argentin, on pénètre un univers de volutes et de courbes, de traits orientaux, expressionnistes…
Johan Huizinga, un historien de la seconde moitié du XIXe siècle, disait, et ce n’est que trop vrai, que la peinture (il parlait de peinture dans le cas précis de son étude historique) et l’écriture ne peignaient pas sur le même degré… ne touchaient pas les mêmes sphères de l’imagination et de l’intellect. Pour une simple raison, la peinture (et par extension le dessin, l’illustration et toute forme, il me semble, d’art visuel) peut transcrire l’ineffable là où le verbe doit se courber, se démener, tergiverser, pour seulement tenter de le faire.
Un récit illustré cosmique
Bref… on est en plein dedans avec Sanyù. Un récit en parallèle. Quelque chose de cosmique. « Ténèbres ! Ô ténèbres ». D’antique. Une sorte d’expiation. « Le clochard se dresse dans les ténèbres éternelles tel un épouvantail ». Du détail. De la folie. Des arbres comme des motifs byzantins. « Rien n’est comparable à mes peupliers blancs d’Étretat, surtout lorsqu’ils sont bercés par le doux noroît ». Des toits comme des vagues. Des traits concentriques sur les corps des hommes comme des stigmates.
On se demande, à la fin, si l’on a parlé de folie, ou du destin tragique de Maupassant, ou de celui de certains êtres sensibles voués à se torturer, ou des écrivains, des artistes, dont le travail acharné de compréhension de l’âme humaine mène fatalement à leur destruction… ou d’autre chose encore… on a l’esprit en vrac et on veut reprendre tout ça, relire un coup, pour remettre dans l’ordre toutes ces fulgurances…
Un vrai beau livre. Plein. Complet. Du quel peut certainement ressortir un Être invisible qui hanterait nos nuits, pour boire notre vie, nous chatouiller l’oreille de son souffle pour nous rappeler que nous ne voyons pas « le centième de millier de ce qui existe » (p.46).