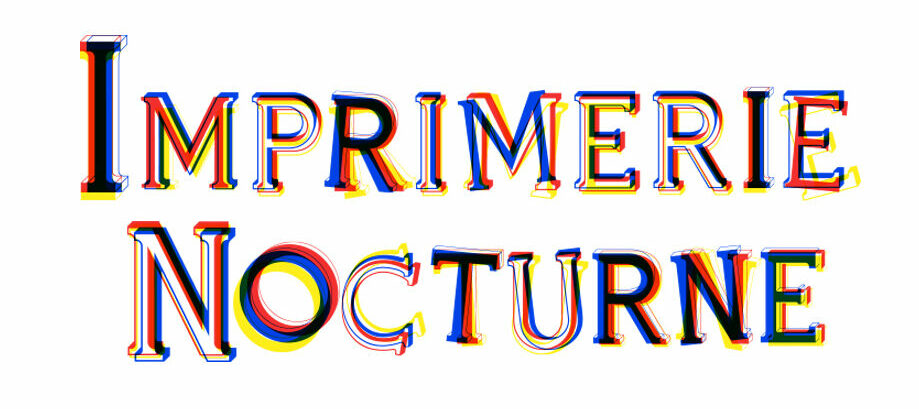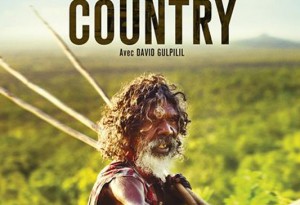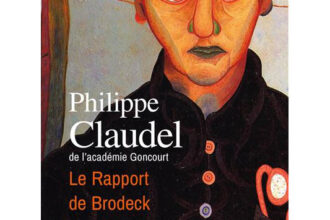Si je peux vous conseiller un bouquin à lire, un seul, genre vous me dites quelque chose comme ça « cette année je ne veux lire qu’un seul bouquin, dis-moi lequel ? », je ne sais pas pour quelle foutue raison vous me diriez un truc pareil, qu’importe, si vous deviez lire un seul bouquin je vous conseillerai Berceuse pour ma mère de Julian Herbert.
Vous allez me prendre pour un monomaniaque, ce qui, soit dit en passant, est peut-être vrai. Mais ce bouquin, c’est encore une des jolies petites créations de la maison d’édition 13e Note. Oui, j’en reparle, pour plusieurs raisons, comme je vous l’ai dit, ce bouquin est d’un superbe à en couper les jambes au plus grand marathonien. Et l’autre raison c’est que cette maison d’édition, comme je vous l’ai déjà dit, est en train de mourir. Enfin… en train… ça m’a l’air d’être bel et bien fini. En mai : ils annoncent la fin. Mais bon, sur leur site ils précisent qu’ils n’acceptent plus de manuscrit en français, qu’ils font tout pour repartir, etc. De mon côté je me dis, ça va redécoller. On peut pas laisser mourir cette maison. Ce sont les plus beaux livres que je vois depuis longtemps et parmi les meilleurs. Je suis alors bougon et tout, mais je me dis ça va redécoller. Juillet : Je retourne voir mon petit libraire préféré (je dis petit, c’est pour le style, il est plus grand que moi), Max, au Pécari Amphibie, j’achète d’autres 13e Note, il m’en conseille… Août : J’y refais un autre tour, en rachète et demande des news à Max sur la maison… il me dit que c’est mort de chez mort pour lui. J’y retourne encore plein de fois. Puis décembre : Je veux acheter un Dan Fante, je les ai quasiment tous mais il me manquait Rien dans les poches, je l’achète, il m’en cause un peu, c’est cool, et je lui repose la question pour être sûr, il me dit là que 13e Note c’est complètement foutu, qu’il liquide les stocks, qu’il leur a bien demandé de lui laisser des livres de côté parce que lui, Max, il en vend et il aime en vendre, et je suis un des acheteurs, mais que bah le stock s’amenuise… là je suis franchement dégouté. Du coup, voilà pourquoi je parle de ça aujourd’hui. Je me dis, si vous avez l’occasion d’aller acheter un, ne serait-ce qu’un, des bouquins de cette superbe maison d’édition, foncez, direct, foncez… Parce que c’est bientôt fini fini. J’ai été sur leur site internet, c’est déjà bouclé… ça fait mal au cul je vous jure, mettez-vous à ma place.
Bon concernant le bouquin. Physiquement ça claque toujours, je veux dire la couv est belle, du blanc, du noir et du rouge, une sacrée typo, et une photo de Ferdinando Scianna prise à Oxaca. De lecture pure, y a 252 pages. C’est correct encore. Je veux dire pour ceux qu’on pas trop le courage de se lancer dans une grande lecture.
Une écriture fine et structurée, chantante, cynique, éclatante, joyeuse, mélancolique et triste
Julian Herbert on le connait déjà. Je vous ai parlé d’un de ces livres il y a quelques mois. C’est le fameux (et provocant mais non moins délicieux) Cocaïne : manuel de l’usager. C’est un Mexicain, il a, comme je le disais justement à ce moment-là, la plume latino-américaine… ça se sent, on a l’impression d’être projeté dans les rues de Mexico, d’Oxaca ou de Guadalajara, après je dis ça j’y ai jamais foutu les pieds, mais limite quand on lit ça sent les fajitas, voyez le genre, et puis la poussière chaude et le soleil sur la nuque… Il a une sacrée écriture, à la fois fine et structurée, chantante, extrêmement cynique parfois aussi, éclatante, joyeuse et foutument mélancolique et triste à la fois et il part de temps à autre dans des digressions philosophiques, introspectives, qui te glacent le sang. C’est un véritable auteur. Il en a toutes les qualités.
Ici, avec Berceuse pour ma mère, il signe un truc vachement émouvant, très personnel. Et il est un auteur véritable à mes yeux, en ce sens où il livre justement des trucs très voire trop personnel, le genre de choses qu’un type normal voudrait plutôt taire et cacher, et moi je dis chapeau et c’est bien comme ça que je vois le boulot d’écrivain, c’est n’avoir pas peur et pas honte de se foutre à poil, devant tout le monde. Mais en même temps et c’est là ce qui fait sa qualité, c’est qu’il romance aussi, il te balade, tu sais pas où est la fiction, ça, tu sais pas le moins du monde, faudrait chercher mais t’as pas envie. Bon je vais quand même y arriver à vous dire de quoi ça cause le livre, sinon vous allez me lâcher, si ce n’est pas déjà fait. Mais je suis tellement excité à l’idée d’en parler, c’est un coup de cœur qui dépasse tous les coups de cœur que j’ai pu avoir…
Le récit de sa mère agonisante, de son enfance et de son amour
Guadalupe Chavez c’est la mère de Julian Herbert. Et puis en fait c’est une ancienne prostituée. On se doute que l’enfance du jeune Julian c’était pas vraiment ça. Tu te dis le type, lui, il devient écrivain, il a une tonne de choses à raconter. Soit… Donc avec sa mère il a une relation particulière. Et c’est la fin pour elle. Parce qu’elle lutte contre une leucémie. Julian est à son chevet, il lui tient la main, il la regarde, il se souvient, et dans le noir de la chambre où Madame Chavez agonise, lui il se lance dans un projet d’écriture, une berceuse scabreuse pour l’esprit du jeune écrivain…
On replonge dans l’enfance de l’auteur, on traverse presque le Mexique, avec toute la ribambelle, et la mère, prostituée qui rentre tard le soir, parfois ivre (je crois que si je devais me prendre des bites dans le cul pour du fric, je rentrerais ivre aussi tous les soirs) qui rentre donc le soir tard et qui va embrasser ses marmots… et y a aussi un max de souvenirs joyeux et des moins… et il s’occupe du récit en parallèle, il explique comment ça se passe pour sa mère et moi ce qui me tue, franchement, et c’est là que c’est un putain d’enfoiré de sacré écrivain, c’est que sa sincérité elle dépasse tout… il en arrive même, un jour, alors qu’il continue d’écrire en face du lit de sa mère qu’on imagine, selon sa description, complètement amaigrie, recroquevillée et chauve, et il se dit, et il nous dit, qu’il en vient à espérer que sa mère meurt… pas uniquement parce qu’elle souffre mais aussi parce que sinon qu’est-ce qu’il fera de son bouquin. Non, mais dit comme ça, ça peut paraitre un truc d’enfoiré, mais sa sincérité dans l’écriture est d’une profondeur assez remarquable.
Il faut lire pour se rendre compte de toute manière. Son style vous transporte. Quand il parle de ses souvenirs de gosse on s’y voit tout de suite. Quand il parle de ses excursions d’écrivain à Cuba, on s’y voit tout de suite, quand il parle de sa mère qu’est allongée et qui parait ressembler à un squelette avec un peu de peau dessus et qui respire faiblement, on s’y voit…
Du coup, pour tout ça c’est dur, c’est poignant, parfois la gorge se noue, tu te demandes comment lui il a fait pour écrire ça alors que même toi la gorge se noue. Et puis c’est émouvant, parce que c’est une sacrée déclaration d’amour d’un enfant à sa mère… une déclaration pas commune, c’est pas du genre « Je t’aime maman, t’es la plus belle, et dans le firmament, tu es éternelle », ah ça non ça n’y ressemble pas le moins du monde. C’est vraiment pas commun. Et c’est beau. Parce qu’une relation, quelle qu’elle soit, n’est jamais parfaite, y a des trucs qu’on reproche, des trucs qui nous agacent chez notre propre mère aussi bien sûr et si on veut faire une vraie déclaration émouvante, sincère, puissante parce que vraie, hé bien faut y aller et dire tout, se foutre à poil… comme il fait dans Berceuse pour ma mère. Ça m’a foutu des frissons. Ça m’a ému. Ça m’a bouleversé. Ça m’a transcendé par moments. Donc voilà, c’est un beau moment de lecture. Lisez-le.
J’ai juste envie de retranscrire ici le premier chapitre du livre (un passage) :
« Enfant, je voulais être chercheur ou médecin, un homme en blouse blanche, mais j’ai découvert mon manque d’aptitudes : il m’a fallu des années pour accepter que la terre était ronde. En public, je faisais semblant. Un jour, dans je ne sais plus quelle école primaire (j’en ai fréquenté 9 en tout), j’ai exposé aux autres élèves, sans le moindre trac, les mouvements de translation et de rotation […]. Mais dans le fond, non, je n’y croyais pas à cette rotondité de la Terre. Je vivais avec l’angoisse orgueilleuse et lucide qui avait mené tant d’hérésiarques à la mort, étripés par Saint Augustin.
C’était la faute de maman. On voyageait tellement que la Terre n’était pour moi qu’un polygone en osier limité de toutes parts par les rails des trains [… je passe des bons passages mais c’est pour vous montrer l’idée quoi].
Tout cela est absurde évidemment. Ça me fait vraiment de la peine, surtout aujourd’hui, quand je vois ma mère sur son lit d’hôpital, les bras meurtris par les aiguilles, connectés à des tubes translucides tachés de sang séché, ma mère transformée en un tableau de chimie où les lettres inscrites au stylo Bic indiquent dans une orthographe hasardeuse les poisons qu’on lui injecte : acétaminophène, ceftazidime (…). Pleurant parce que son fils adoré et détesté (le seul qui a réussi un jour à l’arracher à ses cauchemars, le seul à qui elle aura crié : « Tu n’es plus mon fils, tu n’es plus qu’un chien galeux ») doit lui glisser la nourriture dans la bouche et voir ses mamelons fanés lorsqu’il lui change sa blouse et la porter à bout de bras aux toilettes et écouter – et sentir, elle qui détestait les odeurs – sa mère déféquer. À bout de forces (…). Par sa faute, par la faute d’une folle vie de voyages à travers tout ce satané pays en quête d’une maison ou d’un amant ou d’un employé ou d’une joie qui en cette Douce Patrie n’a jamais existé, je regrette de ne pas avoir été un enfant modèle, un de ces enfants capables de croire que la Terre était ronde. Quelqu’un qui aurait pu lui expliquer quelque chose. Lui prescrire quelque chose. La consoler avec des paroles sur la fugacité de toute chose à l’heure où son corps halète et tremble de peur de mourir. »
Julian Herbert, Berceuse pour ma mère, 13e Note Éditions, pp. 17/18/19.