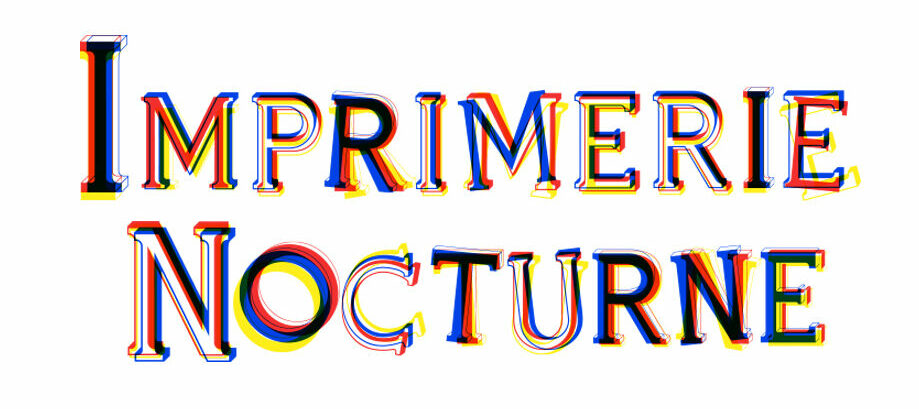Rencontre avec le chorégraphe Loïc Touzé, metteur en scène de Ô Montagne donné au TNB de Rennes début février 2014.
■ Pouvez-vous nous raconter votre parcours au début comme danseur et ensuite comme chorégraphe ?
Jusqu’à l’âge de 17-18 ans j’ai été formé à l’Opéra de Paris, qui est un peu considéré comme le temple de l’académisme classique. Puis je suis devenu un danseur classique professionnel au ballet de l’Opéra de Paris. C’était autour des années 80 et à cette époque-là, il y avait l’explosion de La Danse Française qui regroupait un certain nombre de chorégraphes qui se sont mis à inventer de nouvelles formes de mouvements, une nouvelle idée de la représentation de la danse et du récit. Bien qu’étant complètement dans le sérail de l’académisme, j’étais attentif à ce qui se passait autour de moi. J’avais vingt ans, j’allais voir les spectacles et j’étais très surpris par ce que je rencontrais. Finalement la danse moderne que faisaient les autres était plus adaptée à mon goût. J’avais plutôt envie d’être un danseur contemporain qu’un prince charmant du ballet classique ! J’ai donc décidé de démissionner de l’Opéra de Paris, chose qui est assez rare, car il y a une sécurité d’emploi et c’est un endroit prestigieux, mais je sentais qu’une aventure était possible hors du ballet. Je me suis formé comme danseur contemporain auprès de chorégraphes comme Caroline Carlson, Catherine Diverrès et Mathilde Monnier. Entre 1985 et 1989, j’ai été interprète de ces chorégraphes et je me suis formé à la danse contemporaine.
■ C’est là que commence votre parcours de chorégraphe ?
Oui. Très vite j’ai eu envie de faire mon travail. En 1989 j’ai réalisé ma première pièce, co-signée avec la danseuse Bernadette Doneux, pour voir comment – moi aussi ! – je pouvais inventer un geste, des formes et exprimer un état du monde tel que je pouvais le ressentir. Je considérais que c’étaient des pièces très fraîches, avec peu de connaissances chorégraphiques. J’ai donc finalement décidé de continuer à me former. Ce n’est qu’en 1993, quand j’ai créé l’association Oro, que j’ai réellement commencé à ne faire que mon travail.
Depuis je me suis aventuré pièce après pièce. Aujourd’hui, ça nous amène à Ô Montagne, et à l’envie d’une écriture qui prend à chaque fois des risques sur un sujet ou sur une forme. Mon idée est que la danse est toujours à venir, elle est toujours devant nous. Le travail du chorégraphe, c’est le travail de celui qui se pose la question : « quelle est la danse qui vient ? » Même si la danse du passé est comme un socle sur lequel on peut s’appuyer, on doit se méfier du goût que l’on a d’habitude. Je me méfie même de mon propre goût. Même si elles ne me plaisent pas toujours, j’essaie d’aller vers des choses qui me surprennent. C’est en les fréquentant qu’elles changent le goût !
Le travail du chorégraphe, c’est le travail de celui qui se pose la question : « quelle est la danse qui vient ? »
■ Lors d’une pause théâtre organisé à l’université Rennes 2, Latifa Labissi, co-productrice de la pièce Love, a évoqué la différence entre la danse contemporaine et la danse classique. Quand dans la première, l’approche du corps transforme la voix, le corps et l’espace en matériaux avec lesquels vous vous aventurez et sortez des cases ordinaires, la seconde reste au contraire basée sur des stéréotypes et des techniques bien précises.
Oui. Par exemple, dans le cas de la pièce Ô Montagne, je veux dire que la voix fait partie du corps, qu’elle est une source pour que le geste arrive, une sorte d’embrayage. On peut s’appuyer sur la voix pour appeler des gestes. En travaillant la voix, on ouvre le corps complètement différemment.
Dans la danse classique, on n’aurait pas abordé cette idée. On s’articule autour de l’idée d’un corps qui se construit sur un vocabulaire classique. On est aussi autour d’une technique très difficile qui nous met dans un rapport très sportif à la danse. La pensée est donc organisée autour d’une technique du corps qui ne laisse pas de place à l’aventure. Au contraire, dans cette Nouvelle Danse il n’y a pas un physique de danseur qui serait modélisé. À partir du moment où il y a un désir et un imaginaire de danse, le corps suit. Alors comment stimuler ce désir et cet imaginaire de danse pour que le corps soit au travail du mouvement, qu’il se transforme lui-même par le mouvement ? C’est cette question qui m’a toujours plu. En plus, la danse est poreuse à d’autres champs artistiques et intellectuels. Elle fait de la philosophie en acte, elle pense un certain rapport au temps, à l’espace, à l’autre, à l’image, à la représentation. Elle pense des rapports du corps au monde comme on peut en retrouver chez des philosophes. Toutes ces choses se nourrissent mutuellement. Je crois beaucoup au partage, à la relation qui se crée entre les images et ceux qui les regardent. Je m’inscris dans un courant sensible, poétique. Danser c’est moins montrer un geste que de le rendre visible ; partager avec ceux qui regardent une vision. À partir du moment où le danseur se met à montrer, le public regarde. À partir du moment où le danseur voit, le public voit aussi. J’aime cette idée que le théâtre, comme on le dit d’ailleurs chez les Grecs, c’est le théâtre d’où l’on voit ensemble. On est construit socialement avec l’idée de l’envie de voir ensemble.
■ Selon vous, il y a une projection qui se passe entre la vision des danseurs et la perception des spectateurs et vice-versa. Il y aurait donc une communication implicite ?
Absolument, on fabrique ensemble une image. Une image c’est une relation entre ceux qui exposent et ceux qui assistent. C’est vraiment une circulation. J’essaie de faire en sorte que la pièce ne soit pas complètement terminée tant qu’il n’y a pas de spectateur à la regarder. Il y a toute une part qui reste inachevée et qu’on ne peux pas remplir tant que les danseurs ne sont pas face au public. Le spectacle se passe lorsqu’il est vu, il s’active dans la relation.
La danse développe un rapport du corps au monde comme on peut en retrouver chez certains philosophes.
■ Le spectacle est donc modulable selon le public ?
Le sens global de la pièce reste le même, mais les nuances sont un potentiel pour que les gens les interprètent avec leurs rêves, leurs sensations et leurs idées. La virtualité c’est une puissance d’interprétation. Et il y a beaucoup de sens qui m’échappent sans arrêt, heureusement d’ailleurs ! Finalement, tout ça, c’est créer les conditions de la rencontre avec le goût de chacun. Les gens peuvent aimer ou détester la pièce, la pièce elle-même n’est pas détestable. C’est eux qui la détestent et ça me va, c’est leur affaire !
■ Dès le début de la pièce, les personnages m’ont paru très familiers, comme si je les connaissais depuis longtemps. Qu’est-ce qui vous a amené à affronter la thématique d’une forme de « primitivité » humaine ?

Déjà, avec cette pièce, je m’empare de la mythologie grecque. Ces mythes font partie de notre culture commune. Qu’on la connaisse ou qu’on ne la connaisse pas, c’est un socle sur laquelle on est appuyé. Je crois à la circulation de ces récits qu’on connaît tous et qui nous fondent. Ça c’est la première chose. La deuxième chose c’est que personne n’a d’images vidéo de ce que les Grecs faisaient il y a 2 500 ans en nous disant : « c’est comme ça qu’ils faisaient ! » Nous, on est les Grecs de l’origine, on pense que danser, chanter et parler, ça se faisait de cette manière-là.
Une autre chose qui me semble très importante, c’est qu’on puisse toujours voir les visage et les mains des danseurs. Ça j’y tiens beaucoup. Ce sont des danseurs, des personnes, pas des objets qui s’animent. Ce sont des gens qui sont là, devant nous et qui vont nous raconter des choses de différentes manières avec la voix, avec le corps et l’esprit. On les voit faire, on voit leur imaginaire s’activer. Cette proximité que vous avez ressentie est liée à ça : il n’y a pas de distance car j’ai beau représenter des dieux, je ne renvoie pas le spectateur à une place où lui-même ne pourrait pas être l’un de ces dieux. Ce qui va nous impressionner, c’est leur façon de jouer avec l’imaginaire, pas leur technique. On a donc l’impression que n’importe qui d’entre nous pourrait être là à jouer, parler et chanter. Cette primitivité c’est donc quelque part une proximité, un partage. Mais c’est aussi cette notion de mineur, en opposition à l’idée du majeur qui dit qu’il faut toujours plus et mieux. J’aime bien les choses qui sont simples, parfois un peu bêtes, des choses auxquelles on s’attache moins mais qui ont tout autant de poésie. Essayer de ne pas tout le temps mettre l’accent juste sur une certaine idée de la beauté et de la puissance, ça compte. Il faut dire que les choses sont plus larges que ça.
■ Après le spectacle, en rentrant chez moi, je m’interrogerais encore sur des mouvements vus dans la pièce : « Mais comment elle a fait cette pose ? » Et c’est une question qui m’a travaillée plusieurs jours. Le spectacle a vraiment eu un impact sur ma façon de réfléchir le corps : « finalement je peux me tenir différemment, moi aussi je peux essayer de faire comme le danseur a fait ».
C’est le plus beau compliment que vous pouvez me faire car c’est vraiment ça que je recherche ! Cette accessibilité, cette empathie possible, avec chacun et que tous puissent se dire : « le corps qui est là, c’est le mien aussi ». On parle de moi, on me parle à moi, ce n’est pas une affaire qui m’exclut mais au contraire qui m’inclut. C’est même la question centrale de mon travail depuis toujours. C’est ce qui m’a fait quitter l’Opéra, car lui, il exclut les autres corps. Tout le monde n’aime pas mon travail, certains ne le trouvent pas assez beau, d’autres pas assez puissant, trop faible ou pas impressionnant, comme s’il demandait du temps et des efforts. Ils ont envie qu’on les scotche. Ils ont envie d’une danse qui va les pétrifier. Moi je veux le contraire : que le public soit en mouvement.
Certains ont envie d’une danse qui les scotche, qui va les pétrifier. Moi je veux le contraire : que le public soit en mouvement.
■ Pour recevoir le spectacle,le public doit être dans un état d’esprit apte à cet échange, aux réflexions et émotions qui en découlent. Je sais que ce soir-là j’avais envie de prendre une soirée pour moi. Mais un autre jour, dans un autre contexte, je ne l’aurais peut-être pas perçu de la même façon.
Justement je souhaite que les gens viennent pour eux-mêmes, pour l’expérience et pas pour le geste consumériste que représente un spectacle. J’aime que les gens se posent les questions « Est-ce que j’ai envie de voir ce spectacle ? » « Avec qui ? » « À quel moment ? » Et du côté du chorégraphe, des danseurs, de la troupe, c’est d’une certaine manière 30 ans de travail personnel, 14-15 mois de travail avec une équipe, des heures et des heures de travail. On se prépare longtemps à la rencontre car depuis toujours on cherche l’échange. Par exemple, avec Ô Montagne, les enfants partagent vraiment. J’étais dans une classe de CP, ils m’ont posé des questions pendant 1h30 alors qu’ils sont tout petits ! C’était incroyable ! Ils étaient vraiment embarqués par les histoires. Il étaient d’accord pour jouer avec nous, à croire et plonger dans tout ce que l’on racontait. Au début du spectacle on demande d’ailleurs : « est-ce que vous voyez le vrai ou le faux ? » Pour moi, c’est une véritable entrée dans la pièce, une clé, puisqu’on y joue en permanence avec le vrai et le faux. Ce battement entre les deux, c’est ce qui nous autorise, c’est ce qui nous donne le spectacle comme territoire et c’est ce que je trouve passionnant. On peut dire la vérité avec le faux, comme on peut mentir avec le vrai. Du coup cette frontière-là est moins morale. Elle est plus un mouvement des faits, réflexive, parce qu’il n’y a pas de vérité et pas non plus de mensonge, il y a juste un battement et en fonction de là où l’on est et de comment on l’anime, le sens de ce qu’on fait et de ce que l’on partage peut être habillé de vrai comme de faux. C’est dynamique pour l’imaginaire. Les enfants comprennent ça toute de suite, et je m’adresse aussi aux gens dans cet endroit-là, qui savent encore aller dans une enfance qu’ils n’ont pas oubliée. Pour moi, les gens qui sont présents mais qui ont oublié leur enfance sont morts d’une certaine manière. Ils sont dévitalisés. Je m’adresse aux personnes pour ce qu’elles sont depuis leur enfance jusqu’à maintenant, entièrement, dans un temps présent et dans toute son histoire. Les images qui s’agitent devant elles peuvent venir les chercher dans un endroit de leur mémoire qui est très ancien. Les gens qui viennent en acceptant d’ouvrir ce paysage-là d’eux-mêmes, ils rencontrent les œuvres. Au contraire ceux qui viennent en pensant à leur position, à ce qu’ils représentent aujourd’hui, ils ne peuvent pas rencontrer la pièce.
Toujours avec une envie de partage et d’imaginaire débordant, Loïc Touzé sera de retour à Rennes avec la nouvelle pièce 19 Mélodies et d’autres projets collaboratifs.
Pour plus d’informations : http://www.loictouze.com
Article signé Caterina P.