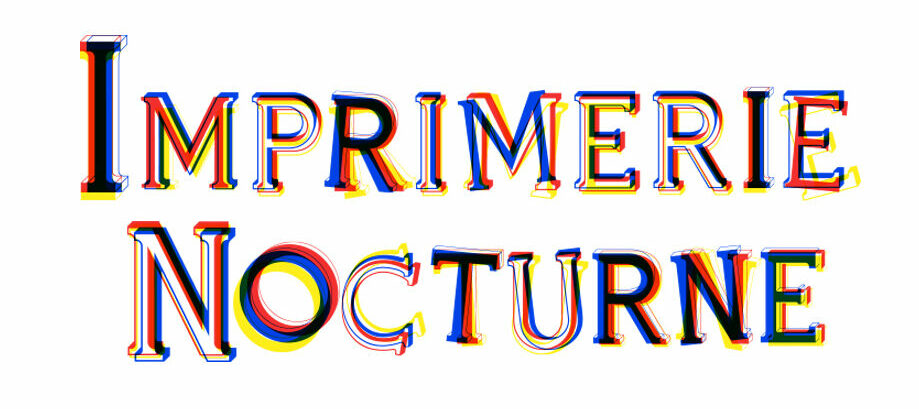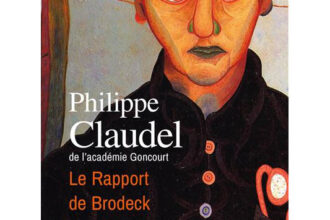Savons-nous aujourd’hui d’où nous vient ce goût de l’aventure ? Cette mystification du vagabond en sac à dos ? Notre génération lit-elle encore London ?
Notre génération a le goût de l’instabilité. Nos illusions sont mortes il y a peu et nous partons en quête de nouveaux espaces, à la rencontre de nouvelles cultures. Nous croyons que d’une acculturation globale le monde renaîtra de ses cendres. Nous allons chercher ailleurs, loin, nos amitiés, nos souvenirs et construire nos aspirations dans un monde en mouvement. Il suffit de voir aujourd’hui le nombre de jeunes Français qui migrent un temps vers l’Australie, l’Asie ou encore l’Amérique du Sud. Nous pensons y trouver l’ouverture d’esprit qui nous permettra de comprendre ce monde globalisé. Nos plateformes sociales et virtuelles nous permettent de garder contact avec ces amitiés éphémères. Nos sacs à dos attendent dans les greniers et dans les chambres. Ils n’ont pas le temps de prendre la poussière que déjà celle des routes s’envole dans notre dos. L’image est belle mais en est-il vraiment ainsi ?
 Bien avant les hippies et leurs voyages initiatiques en Inde et les processions idéologiques tout au long du Hippie trail, avant la Beat Generation, bien avant cela, à la fin du XIXe siècle, les hobos, travailleurs vagabonds, trimardeurs, traîne-savates, parcouraient les États-Unis de long en large à la recherche de travail mais aussi d’aventures. London, dans son roman Les vagabonds du rail, évoque son passé de hobo et décrit cette Amérique non conformiste, libre, qui continue aujourd’hui de faire fantasmer les jeunes du monde entier. « C’est que la vie qui débordait en moi, l’amour de l’aventure qui coulait dans mes veines, ne me laissaient aucun répit […] Je « brûlai le dur »[1]… parce qu’il me répugnait de moisir sur place ». Dans Les vagabonds du rail, il raconte donc l’épopée des milliers de « hobos » marchant vers le Nord à la recherche d’un gagne-pain. Il brûle le dur, esquive les « taureaux », cette flicaille agaçante qui pourchasse les clandestins qui sautent de trains en trains pour rejoindre, le dos courbé, la ville prochaine. Ce n’est ni pitoyable, ni misérabiliste, bien au contraire, une série d’anecdotes au plus près du réel. On retrouve le réel partout dans ses romans. Voilà, ce qu’il est, un auteur du réel. Une poigne virulente, à chacun de ses mots. Une simplicité rigoureuse et une fameuse acuité. Un écrivain pluriel, ubiquiste et réaliste.
Bien avant les hippies et leurs voyages initiatiques en Inde et les processions idéologiques tout au long du Hippie trail, avant la Beat Generation, bien avant cela, à la fin du XIXe siècle, les hobos, travailleurs vagabonds, trimardeurs, traîne-savates, parcouraient les États-Unis de long en large à la recherche de travail mais aussi d’aventures. London, dans son roman Les vagabonds du rail, évoque son passé de hobo et décrit cette Amérique non conformiste, libre, qui continue aujourd’hui de faire fantasmer les jeunes du monde entier. « C’est que la vie qui débordait en moi, l’amour de l’aventure qui coulait dans mes veines, ne me laissaient aucun répit […] Je « brûlai le dur »[1]… parce qu’il me répugnait de moisir sur place ». Dans Les vagabonds du rail, il raconte donc l’épopée des milliers de « hobos » marchant vers le Nord à la recherche d’un gagne-pain. Il brûle le dur, esquive les « taureaux », cette flicaille agaçante qui pourchasse les clandestins qui sautent de trains en trains pour rejoindre, le dos courbé, la ville prochaine. Ce n’est ni pitoyable, ni misérabiliste, bien au contraire, une série d’anecdotes au plus près du réel. On retrouve le réel partout dans ses romans. Voilà, ce qu’il est, un auteur du réel. Une poigne virulente, à chacun de ses mots. Une simplicité rigoureuse et une fameuse acuité. Un écrivain pluriel, ubiquiste et réaliste.
Jack London n’a jamais été autant d’actualité qu’aujourd’hui. Nous ne tenons plus en place. Mais cette bougeotte touche tous les jeunes Occidentaux. Des bourgeois affranchis aux plus modestes. Nous rêvons tous d’aventures, d’aventures à la London, de ne savoir comment nous mangerons demain, de ne savoir comment nous nous rendrons dans telle ou telle ville, de nous retrouver à geler aux abords d’un entrepôt par des nuits froides et effrayantes, de nous poser le cul dans l’herbe, une brindille coincée entre les dents, à contempler les étendues majestueuses s’éveiller aux premières apparitions du soleil, à dormir à la belle étoile. Nous rêvons tous de cela. Mais nos aventures sont bien moins spectaculaires. Nous avons encore besoin de rêver. Nous avons pour cela besoin d’exemples.
Parce que sans le savoir, nous sommes pourtant ses fils.
Pourquoi lire, ou relire, Jack London ? L’auteur du fameux Croc-Blanc, ou encore de L’appel de la forêt, n’est pas qu’un auteur pour enfants rêvant d’aventure. Il est cela, mais tout autre chose en même temps. Ses critiques acerbes de la condition des prolétaires de l’East End de Londres dans Le peuple de l’abîme, ou encore du milieu carcéral dans Le vagabond des étoiles, ses aventures, nombreuses, dans les mers du Nord, du Sud, du Pacifique, en font un écrivain aux joues rouges, au pif de même et aux mots bruts qui caressent bien fermement une réalité qu’il connaît. Il est engagé avec ses doigts qui griffent le papier, mais avec son corps, tout entier, il est vivant, tout en nerfs et en passions. Et homme de cette bonne vieille terre, il n’a jamais cessé de voir, de regarder.
Pourquoi doit-on encore le lire, alors ? Pour ce qu’il dit, pour la manière dont il le dit, pour ce qu’il a à nous apprendre de son temps et du nôtre. Pour ce qu’il a à nous faire comprendre. Un auteur qui ose, non pas seulement écrire mais aussi faire. Un auteur qui vit avant de se penser. Il a l’estime bien établie, on ne peut pas lui enlever. Mais pour autant, il baragouine avec nos mots, il n’alambique pas, il ne cherche pas à étonner, il est subversif pour ce qu’il représente. Il est l’auteur que nous nous devons de lire aujourd’hui plus que jamais. Pourquoi ? Parce qu’il est à la base de notre imaginaire. Parce que sans le savoir, nous sommes pourtant ses fils, nous, générations instables et vagabondes, mondiales et solitaires, illuminées et réelles.
[1] « Brûler le dur » : voyager en train sans payer de billet. Il ne s’agissait pas uniquement, à la fin du XIXe siècle, de frauder. C’était toute une aventure, dangereuse, périlleuse que de brûler le dur.